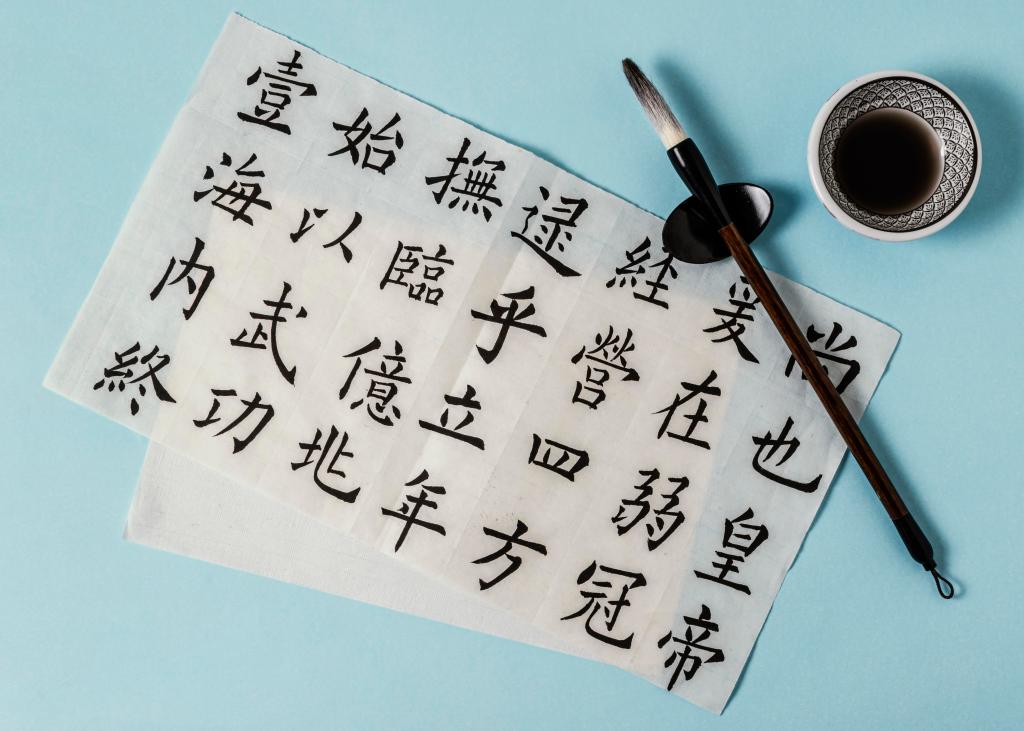Chaque fois que je m’apprête à donner des formations ou des conférences à un public européen, les mêmes doutes m’habitent : ce que j’ai à dire est-il pertinent pour eux?
Les traducteurs canadiens, je les connais pour ainsi dire comme le fond de ma poche : nous avons beau être très nombreux, très différents et travailler dans des contextes très variés, il est étonnant de constater à quel point nous avons à peu près tous les mêmes travers, les mêmes questionnements et les mêmes limitations (souvent purement théoriques), le tout issu d’une formation et d’un contexte sociopolitique relativement homogènes. En un mot, j’ai des choses à dire à mes consœurs et confrères du Canada, des choses à discuter avec eux, ça je n’en doute pas.
Mais les Français, les Belges et les Suisses exercent dans un contexte beaucoup plus hétéroclite, ils manient une langue qui n’est pas exactement la nôtre et leur formation suit une autre tradition.
Et je sais pertinemment, avec l’expérience, que certains de mes enseignements ne les concernent guère. Par exemple, quand j’explique qu’il n’y a pas lieu de traduire systématiquement performance par rendement, en Europe, on tombe des nues. Ou encore, j’ai constaté cette semaine qu’un de mes exemples fétiches pour illustrer ce qu’est un « mot du paradis du français », le mot concertation, à peu près inconnu au bataillon des traductions françaises du Canada, est utilisé à profusion en Belgique parce que correspondant directement au flamand overleg.
Donc, différences, oui, mais à chaque fois, je redécouvre ce qui nous réunit : l’amour de la langue en soi, la recherche perpétuelle de la clarté et du mot qui « sonne juste », la fascination de ce mystérieux décalage entre des phrases qui sont censées dire la même chose sans jamais tout à fait y arriver.
C’est ce genre de jubilation que j’ai partagé les 19, 21 et 25 octobre avec, au total, environ soixante-dix confrères et consœurs de la SFT, puis les 29 et 30 octobre avec presque autant de traducteurs et traductrices en Belgique.
Et la traduction neuronale, dans tout ça?
C’est sûr, si j’avais proposé des cours sur la traduction neuronale, j’aurais probablement eu des assistances encore bien plus imposantes, et la rentabilité de la tournée n’aurait pas été une question. Mais ce n’était pas de ça que j’avais envie de parler, et apparemment, ceux qui sont venus à ma rencontre non plus.
Ce qui n’empêche pas que, bien sûr, on en a parlé. Ça et les autres outils d’aide à la traduction.
Mon idéal à moi – et il est partagé par mes confrères et consœurs, et il devrait l’être par tout le monde –, c’est de préserver et de faire rayonner à son plus haut potentiel le génie de chaque langue. Car c’est lui, le génie, qui est menacé quand un texte passe par le tordeur de la traduction.
Or les outils, et récemment la traduction neuronale, piquent obstinément des tangentes vers d’autre chose.
Les mémoires de traduction – dont on ne saurait nier l’utilité – nous incitent à segmenter des textes qui, nous le savons tous pourtant, forment un tout. Elles sont en outre généralement utilisées d’une manière qui tend à perpétuer les erreurs et maladresses du passé au lieu d’améliorer les différentes moutures d’une phrase avec le temps.
La traduction neuronale, pour sa part, produit des traductions techniquement impressionnantes quand on sait tout ce que requiert cette opération linguistique, mais qui suintent la bêtise, le plat, l’irréflexion, bref l’inhumanité.
Dans mes formations, on réfléchit à ce qu’est une bonne traduction, on convient d’une définition, d’un résultat à atteindre, et systématiquement, au milieu de l’enthousiasme que procure le sentiment d’avoir touché du doigt ce qui donne du sens à notre travail, il y a quelqu’un pour siffler la fin de la récréation :
– Oui, mais les outils nous amènent ailleurs.
Alors nous, on fait quoi?
Je suis frappé par les mesures herculéennes que prennent les militants de certains mouvements dans le domaine de la langue (rédaction inclusive, « langue claire et simple ») pour changer le monde conformément à leur idéal. Ils organisent des colloques et des formations, mettent en place des logiciels d’analyse qui nous attribuent des bonnes et des mauvaises notes comme à des enfants, convainquent les décideurs d’adopter des politiques qui seront ensuite imposées aux rédacteurs par des moyens parfois musclés, parfois soft.
Alors pourquoi les traducteurs qui savent ce qu’est une bonne traduction, les traducteurs qui définissent la qualité de la traduction par des valeurs bonnes et universelles comme la clarté du message et la préservation du génie de chaque langue – donc la sacro-sainte diversité, bon’yeu! – se couchent-ils devant les concepteurs de logiciels et les décideurs de tout poil qui leur disent à eux, des professionnels, quels outils utiliser – et comment les utiliser?
Je ne sais pas quel est l’avenir de la traduction. Je sais une chose toutefois : on pourra nous proposer tous les outils qu’on voudra, ce sont les traducteurs, en tant que spécialistes, qui doivent définir ce qu’est une bonne traduction.