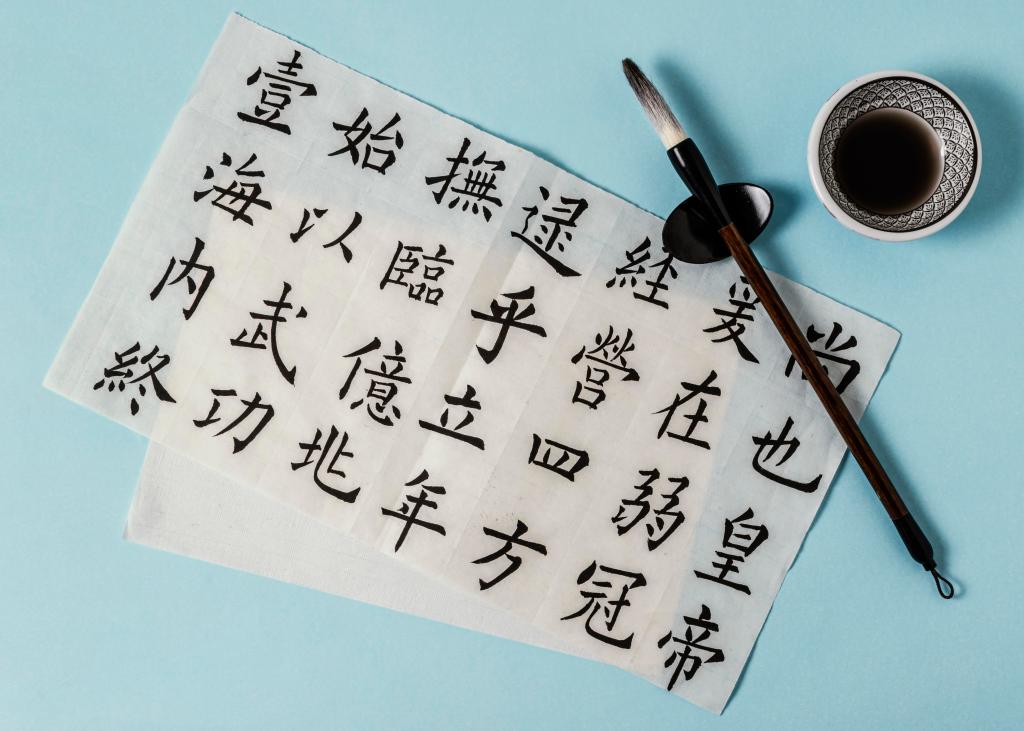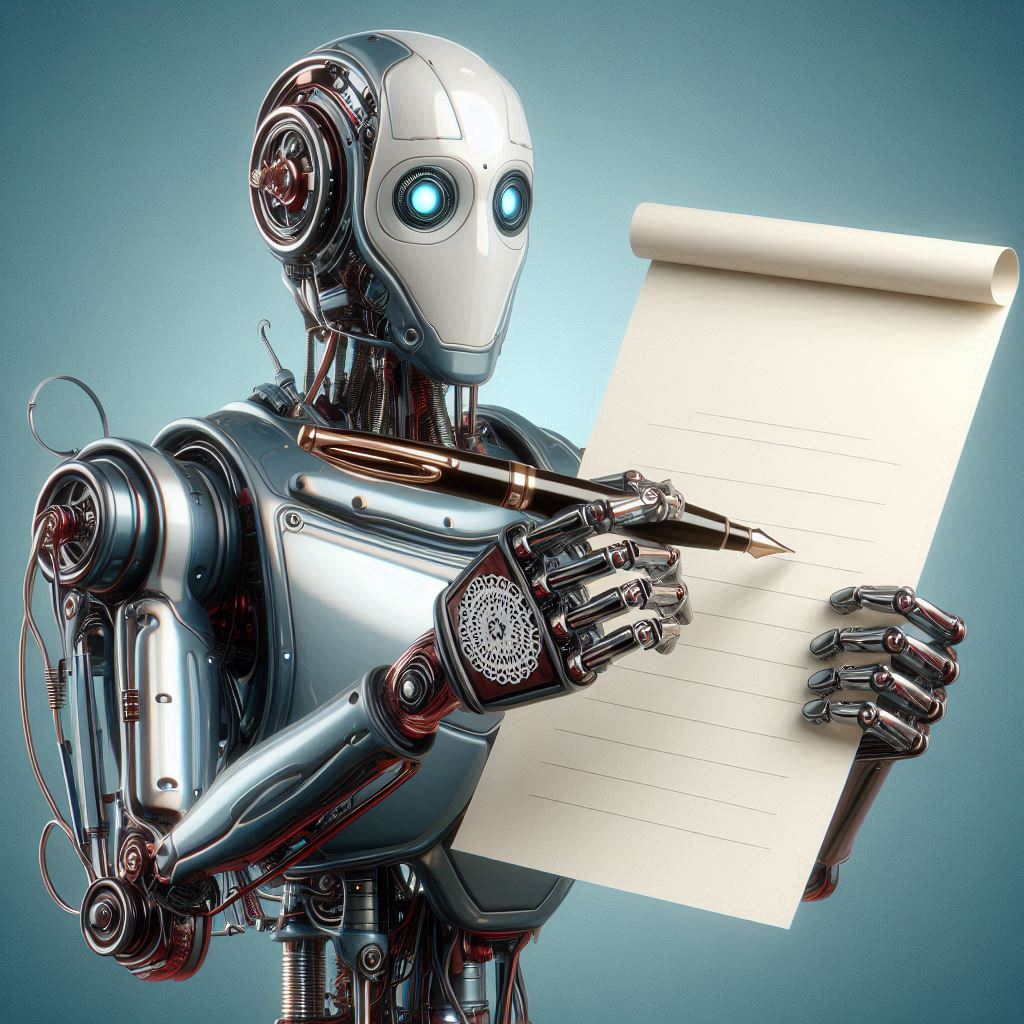-
Traduire des sites Web en 2026

Christine Fournier
On est en 2012, je me dresse devant un groupe d’étudiants universitaires. Mon sujet? Une nouveauté au programme de traduction : la rédaction pour le Web. Pendant 45 heures, nous parlerons de référencement, d’ergonomie, d’architecture, d’accessibilité, de lisibilité, d’hypertexte, de genres numériques… Des notions qui allaient désormais faire partie du quotidien du rédacteur Web et qui allaient inévitablement faire leur entrée dans le monde de la traduction.
Depuis, je m’efforce de former étudiants et collègues. De dire haut et fort qu’on ne peut pas traduire un texte destiné à la toile comme on traduit n’importe quel autre texte. Il faut d’abord connaître l’écriture Web, et surtout savoir reconnaître les choix rédactionnels que l’auteur a faits pour produire un contenu qui plaît aux internautes et qui sera repéré par les moteurs de recherche. Une traduction qui ne prend pas ça en compte risque d’effacer tous les efforts d’optimisation et ne sera pas à la hauteur du texte de départ.
J’ai toujours perçu la traduction Web comme une expertise discrète, mais puissante.
Je m’explique. Elle est discrète, car chaque petit choix appuyé sur un concept de référencement, d’architecture ou d’accessibilité, par exemple, est presque imperceptible dans le texte. L’œil non averti ne détectera jamais ces manipulations subtiles qui, pourtant, ont le pouvoir de rendre une traduction visible. Ce sont elles qui hissent les pages Web au sommet des résultats de recherche. Ce sont elles qui accrochent le lecteur et l’incitent à poursuivre sa visite du site et à y revenir. Ça, c’est de la puissance!
Et je vais plus loin. Selon moi, la traduction pour le Web est l’une des activités qui est venues décristalliser notre rôle de traducteur. C’est une occasion de montrer à nos clients qu’on suit les tendances, qu’on possède des connaissances techniques hautement exploitables, qu’on ne fait pas que changer des mots d’une langue à une autre et qu’on est de précieux alliés dans leurs stratégies de communication et de marketing. Puissance au carré!
Le doute s’installe…
Mais voilà, en 2025, j’ai un peu perdu mes repères. L’IA a chamboulé tellement d’habitudes. Je ne parle pas juste de notre méthodologie de la traduction, de la fidélité de nos clients ou de la nature de nos mandats. Pensez aux pages de résultats de recherche qui nous crachent des réponses générées par l’IA (l’ère du zéro clic) ou encore à l’explosion de contenus écrits par des machines plutôt que par de vrais rédacteurs. Bref, pour être honnête, j’ai douté de la pertinence de mon expertise en traduction Web.
J’aborde 2026 d’un nouvel œil, convaincue qu’il y a un avenir pour la traduction Web.
Certains principes sont inébranlables. En fait, ils font en sorte que nos textes se démarquent. Je vous donne quelques exemples.
D’abord, si on pense à nos lecteurs, il y a la rédaction∕traduction centrée sur l’utilisateur. Celles et ceux qui ont participé à mes formations se souviennent peut-être de ce principe qui vise à choisir des mots et des tournures qui créent un dialogue avec le destinataire. La machine n’arrive pas à tisser un tel lien.
Les principes de lisibilité sont aussi là pour de bon. Avouons-le, les textes générés par l’IA sont redondants et loin de la richesse lexicale attendue d’un texte rédigé par un professionnel. Mentionnons aussi la structure, la diversité des phrases, le ton… Bref, tout ce qui rend un texte lisible et agréable et qu’un contenu machine n’arrive pas à offrir.
Ensuite, quand on parle de Web, on doit nécessairement penser à la façon de trouver des contenus. Traduire pour le Web, c’est aussi s’occuper du référencement (SEO), c’est-à-dire de rendre les textes visibles sur les pages de résultats de moteurs de recherche. Ici, ça bouge vite. Sans nécessairement se transformer en référenceur professionnel, il faut suivre les tendances (le GEO, entre autres). Mais certains principes demeurent : richesse lexicale, zones chaudes et hypertexte, par exemple.
Je décide aussi de surfer sur la vague du changement. Voici quelques exemples de ce que 2026 réserve à la traduction Web.
Ces jours-ci, les moteurs de recherche et l’IA sont avides de contenus ultrastructurés. Ça ne peut pas nuire à la qualité de nos traductions. Amusons-nous donc avec les titres et les sous-titres.
Il faudra aussi miser sur une approche multiplateforme. Quand ils cherchent des réponses, les internautes se contentent souvent de lire les aperçus générés par l’IA. Les sites Web ne sont plus la porte d’entrée principale vers les contenus. Pour riposter, vos clients voudront probablement créer d’autres « portes » en redoublant leurs efforts dans les médias sociaux ou sur leur chaîne YouTube, par exemple. Rappelez-leur que vous possédez l’expertise pour traduire des publications Instagram et faire du sous-titrage!
Dans mes formations, j’insiste sur l’importance de bâtir une banque de mots-clés avant de commencer la traduction d’une page Web. Eh bien, bonne nouvelle, l’IA est particulièrement efficace pour accélérer cette tâche. Il existe aussi de plus en plus d’outils pour vous aider à bien choisir vos mots-clés.
Conclusion
Finalement, traduire des sites Web en 2026, c’est :
- comprendre la nouvelle mécanique du monde numérique;
- mettre à profit notre expertise de langagier pour créer et traduire des textes qui répondront aux besoins émergents des machines et des utilisateurs;
- se fier aux bons fondements de la rédaction et aux principes Web qui ont fait leurs preuves pour agrémenter l’expérience utilisateur.
-
Traduction publicitaire : soyez la chèvre!

Christine Fournier
J’ai récemment eu le plaisir de participer au balado Trad. Vous connaissez? Dans ses émissions, l’animatrice et traductrice Anabelle Pronovost rencontre des invités pour discuter, entre autres, d’idées reçues et de domaines spécialisés de la traduction.
Voici donc un aperçu de notre entretien sur l’adaptation publicitaire, un domaine qui peut sembler intimidant, mais qui invite à plonger dans notre propre culture.
Qu’est-ce que la traduction publicitaire?
La traduction publicitaire est un exercice d’adaptation. À quelques exceptions près, la fidélité et l’exactitude du message, parfois même le sens, sont mis de côté au profit de l’effet créé. En publicité, l’objectif est de faire réagir, de faire passer les consommateurs à l’action ou au moins de marquer leur imaginaire. On va donc se distancer du texte source et travailler avec une approche très cibliste qui considère les valeurs, les croyances, les références culturelles, les expressions, le sentiment d’appartenance et les intérêts des destinataires.
C’est un travail qui demande des connaissances de base en publicité, une grande créativité et une approche différente par rapport à la traduction de textes d’autres genres.
Que doit-on faire avant de traduire une publicité?
- Avoir les connaissances de base en adaptation publicitaire. Connaître :
- la nature du texte publicitaire (objectifs, notions de psychologie);
- les caractéristiques d’un bon titre, d’un bon texte, d’un bon slogan;
- les tendances : qu’est-ce qui fonctionne en publicité en 2026?
- Analyser la publicité
- son objectif;
- son destinataire source et son destinataire cible;
- ses codes (type de texte, mots, images, mouvements, mise en page, couleurs, symboles, formes).
À qui doit-on s’adresser?
À la culture cible! Ensuite, il faut raffiner selon le mode de diffusion : télé, médias sociaux, bannière Web, panneau d’autoroute. À chaque support ses préférences et son public.
Il est crucial de poser des questions au donneur d’ouvrage. Il faut découvrir à qui il veut s’adresser. Il faut avoir un portrait clair : âge, statut socioéconomique, intérêts, objectifs, besoins, situation géographique, profession, etc. Parfois, nos questions font réfléchir le client, d’autre fois, celui-ci nous fournira un portait détaillé : un dossier avec des statistiques issues du Web, des profils de personas, des études de marché, etc.
Est-il possible de changer l’image?
Dans un monde idéal, le traducteur intègre l’équipe de création d’une campagne multilingue, il participe au processus de création et agit comme conseiller expert de la langue cible. Il participe au choix des images.
Mais, la plupart du temps, la publicité est déjà ficelée quand elle arrive sur notre bureau. Le traducteur arrive en aval et il est trop tard pour changer l’image, même si à première vue, elle ne semble pas rejoindre le public cible ou correspondre aux mots qui l’accompagneront.
Il faut user de créativité! Heureusement, il existe des trucs pour nous faciliter la tâche.
Quelles sont les erreurs les plus courantes en traduction publicitaire? Penses-tu que la traduction SOYEZ LA CHÈVRE qu’on a vue dans les rues de Montréal il y a quelques années comme traduction de BE THE GOAT, était intentionnelle?
Vous ne serez pas surpris si je réponds que l’erreur la plus fréquente est le recours à la traduction machine ou à la traduction littérale, sans prendre en compte le contexte culturel.
Dans une publicité de chaussures de randonnée, l’entreprise Columbia a traduit BE THE GOAT par SOYEZ LA CHÈVRE. Des bannières qui ornaient le magasin La Baie à Montréal affichaient ce slogan, avec l’image d’une chèvre et d’un randonneur. Ce n’est pas la première entreprise à produire ce genre de traduction.
On voit que le slogan en anglais fonctionne, puisqu’il fait référence à l’acronyme Greatest Of All Time (même si Columbia s’en défend) – il invite à se surpasser et il fait référence à l’animal habile dans les sentiers montagneux.
En français, on ne s’est pas assez distancié de la langue source. Non seulement on perd le sens de GOAT comme « meilleur de tous les temps », mais, en plein centre-ville de Montréal, on voit mal l’avantage d’être une chèvre. On sent une rupture.
Que ce soit intentionnel ou non, il y aurait eu de belles possibilités pour joindre le public montréalais. On aurait pu parler d’atteindre des sommets, par exemple.
Comment les différences culturelles peuvent-elles conduire à la création de slogans totalement différents dans plusieurs marchés?
Certaines références ne résonnent tout simplement pas, comme dans le cas de GOAT avec chèvre. Parfois, c’est une question de valeurs, de contexte historique ou politique ou de perception de l’humour, par exemple. Ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas nécessairement pour l’autre. Le rôle du traducteur publicitaire est de se rapprocher le plus possible de la culture cible, c’est normal que les solutions de traduction soient différentes d’un public cible ou d’un marché à l’autre.
Quelles sont les stratégies (jeux de mots, figures de style)?
Sans nommer toutes les stratégies, je peux dire qu’il faut aller puiser dans les ressources de la langue cible. De plus, il faut rester au fait des bons coups publicitaires, des annonces coups de cœur, des slogans qui restent. Qu’est-ce qui pogne? Comment on dit ça chez nous? Qu’est-ce qui est idiomatique?
Quelles ressources recommandes-tu?
Il y a beaucoup de bons articles universitaires sur le sujet, selon vos intérêts précis, je vous conseille d’aller fouiller dans les bases de données. Quand on parle de théorie de l’adaptation publicitaire et de processus, j’aime beaucoup l’approche d’Hugo Vandal-Sirois, mais il y en a plein d’autres.
Si vous aimez les trucs pratiques et les exemples, consultez les articles du Traducteur averti. François Lavallée y donne de précieux conseils sur la traduction des titres et des slogans.
Finalement, je vous recommande d’explorer le monde publicitaire de votre culture cible. Au Québec, par exemple, il y a les sites Web, les blogues et les chaînes YouTube des grandes agences de communication. Ou encore, vous pouvez suivre des profs d’université qui enseignent dans le domaine, comme Claude Cossette ou Luc Dupont. C’est une façon simple et intéressante de se garder au fait des tendances en publicité.
- Avoir les connaissances de base en adaptation publicitaire. Connaître :
-
Je suis Pékin

Extrait d’un livre en cours de rédaction sur la langue française, à paraître en 2026. Pour voir d’autres extraits, on peut s’abonner à la page Facebook Ma langue française.
[…] Je viens de parler des fantômes qui font boo au lieu de bouh. En effet, oo est une façon d’écrire le son [u][1] en anglais, et non en français. En français, à la base, ce son s’écrit ou. En espagnol et dans bien d’autres langues, il s’écrit u. Le français se démarque à cet égard. Pourquoi? Parce que la lettre u est réservée en français au son [y], son qui n’existe tout simplement pas dans les autres langues latines (espagnol, portugais, italien, roumain), ni d’ailleurs en anglais!
Cela peut paraître futile, mais c’est une autre illustration des manières subtiles dont l’anglais s’immisce dans l’univers francophone. Le français a une manière de faire les choses, l’anglais en a une autre, et c’est par ignorance ou négligence qu’on mélange les deux.
Qu’est-ce que la translittération? En russe, par exemple…
Ce qui nous mène à la fascinante question de la translittération. Qu’est-ce que la translittération? C’est la façon d’écrire dans notre alphabet les mots qui viennent de langues qui en utilisent un autre. Ce n’est pas de la traduction. Par exemple, si je vous montre le mot russe стол, je pourrais vous le traduire en disant que cela signifie « table », mais je pourrais aussi simplement le translittérer pour vous indiquer comment ça se prononce, ce qui donnerait stol.
Maintenant, pour revenir à notre son [u] (ou), comment s’écrit-il en alphabet cyrillique, qui est l’alphabet russe? Réponse : y. C’est la deuxième lettre de Путин, le nom de Poutine. Et comment les anglophones écrivent-ils le nom du président russe? Putin, bien sûr, puisque chez eux le u se prononce ou. Quant au e final de Poutine en français, il n’est pas dans la graphie russe, qui se termine par le n (représenté par н, oui, je sais, c’est mêlant), mais on l’ajoute parce que c’est ainsi qu’on va s’assurer que le francophone prononcera -ine et non -in (autre son français qui n’existe ni en anglais ni dans les autres langues romanes).
Vous me direz que porter le nom d’un mets composé de patates frites et de sauce brune, pour un chef russe, ce n’est pas ce qu’il y a de plus glorieux mais, comme on le constate quand on regarde ce qui se passerait si on gardait la graphie anglaise en français, cela aurait pu être pire.
Et pourquoi donc ce « pire » aurait-il pu advenir? Parce qu’on voit souvent les translittérations anglaises se faufiler subrepticement dans le français, en raison sans doute de l’ignorance des gens qui écrivent. Par exemple, on voit parfois le nom du compositeur russe Chostakovitch écrit Shostakovich, ce qui est en fait la translittération anglaise : en français, le son [ʃ] s’écrit ch, alors que ces deux lettres se prononcent [tʃ] en anglais. C’est pourquoi les anglophones font commencer le nom de ce compositeur par sh, qui n’est, pour sa part, pas une combinaison de lettres native du français. De même, le ch de la fin en anglais se prononce [tʃ], ce qui s’écrit tout simplement et logiquement tch en français. On pourrait énumérer ainsi plusieurs lettres cyrilliques correspondant à des sons qui s’écrivent différemment selon qu’on est en anglais ou en français.
Les journalistes tombent souvent dans le piège. André Racicot, spécialiste de ces questions, signale toutefois que les médias français semblent moins hypnotisés que les médias canadiens à cet égard :
Cette question épineuse était de la sorcellerie aux yeux des médias, qui ont bien des chats à fouetter. Pourtant, une observation attentive de la presse française montre que les noms russes sont francisés. Par exemple Youri Loujkov, ancien maire de Moscou que les médias francophones canadiens écrivaient Yuri Luzhkov, dans l’indifférence générale. […] Il est […] bien difficile de demander à de courageux reporters comme Tamara Altéresco de se pencher sur la francisation d’Irpin, entre deux bombardements russes. Mais les chefs de pupitre, eux, pourraient le faire à sa place[2].
Les Allemands, pour Vladimir, écrivent Wladimir, parce que chez eux, le w se prononce [v]. Il n’y a aucune raison pour nous de faire de même. Il n’y a aucune raison non plus de faire comme les anglophones.
Qu’en est-il de l’arabe et de l’hébreu?
Le même problème se pose pour les mots arabes et hébreux, dont l’original s’écrit aussi dans des systèmes d’écriture autres que le nôtre. Ainsi, on écrit Yom Kippour en français et Yom Kippur en anglais. Et on écrit Anouar en français et Anwar en anglais. On dit toujours que les noms propres ne se traduisent pas, mais dans ce cas-ci, il ne s’agit pas de traduction mais de translittération. Si on traduit de l’anglais un nom russe, arabe ou hébreu, il faut adapter la graphie au système d’écriture du français, d’autant plus que c’est ainsi qu’on aidera le lecteur à bien le prononcer. Ainsi, on voit souvent Rosh Hashanah en français, mais comme l’indique à point nommé Wikipédia, il s’agit de la graphie anglaise, et on devrait écrire en français Roch Hachana.
Et il ne s’agit pas que des noms propres. Ce que les anglophones translittèrent hijab et jihad, il est normal qu’on l’écrive en français hidjab et djihad, car le j seul ne se prononce pas [dʒ] en français, contrairement à l’anglais. Pour certains mots, comme charia (angl. sharia), la graphie française est bien établie. Pour d’autres, moins.
Encore une fois, il faut comprendre le contexte de tout cela : il ne s’agit pas de savoir comment translittérer l’arabe, il s’agit de ne pas laisser l’anglais s’immiscer entre l’arabe et le français. C’est d’autant plus difficile que l’anglais occupe une place hégémonique dans les choses internationales; mais au fond, ce n’est qu’une question d’information et de vigilance.
Cette manie de tout prononcer à l’anglaise…
J’en profite pour signaler la fâcheuse manie des Québécois (y compris dans les médias) de prononcer à l’anglaise tout nom étranger, ce qui trahit un esprit étriqué, comme si tout ce qui n’est pas français devait être anglais. Le regretté Alix Renaud faisait la même observation :
Dans le cours d’expression orale dont j’ai la charge au Collège radio-télévision de Québec (C.R.T.Q.) depuis plus de dix ans, j’aborde à la mi-session la prononciation des mots étrangers (en particulier celle des noms propres). Je m’étais en effet aperçu, dès le début, que la plupart des élèves avaient tendance à prononcer à l’anglaise tout mot ou tout nom qu’ils ne connaissaient pas […][3].
La chose a été mise au clair par le hockeyeur slovaque Peter Stastny lorsqu’il est arrivé à Québec en 1980 : son nom se prononce « Pétère » et non Peter à l’anglaise. En l’occurrence, les commentateurs sportifs se sont fait un point d’honneur d’obtempérer, mais beaucoup continuent encore aujourd’hui de prononcer des noms slaves ou scandinaves à l’anglaise.
Quand la Russie se défrancise…
Pour revenir au russe, la question s’est malheureusement compliquée il y a une trentaine d’années :
Depuis que la Russie a adopté, au milieu des années 1990, la transcription des noms russes sur les passeports selon la phonétique anglaise en remplacement de la phonétique française (traditionnelle depuis l’époque tsariste), il est de coutume d’adopter dans les médias francophones cette forme anglaise (c’est généralement le cas des sportifs, par exemple : la joueuse de tennis Svetlana Kuznetsova au lieu de Svetlana Kouznetsova)[4].
Cette décision des Russes me fait un pincement au cœur, car c’est un autre signe du déclin du français sur la scène internationale, un français qui avait pourtant occupé une place de choix dans ce pays depuis Pierre le Grand (1672-1725). Mais elle ne concerne que la transcription pour les passeports; on comprend les Russes de choisir l’anglais comme vecteur de communication internationale, et il serait un tantinet tatillon de leur demander de rajouter une translittération française à côté de la translittération anglaise sous le nom en cyrillique! Mais rien n’oblige par contre les journalistes ni quiconque d’autre à adopter un système phonologique étranger (anglais ou autre) dans leurs écrits en français. D’autant plus que, comme on le signale dans Wikipédia, la translittération anglaise « n’est pas sans provoquer des erreurs[5] » en français : par exemple, le nom du joueur de tennis Михаил Южный, dont le patronyme se prononce (et devrait s’écrire) Ioujny, est plutôt écrit à l’anglaise, soit Youzhny, ce qui amène les gens à le prononcer « Iouzny ».
L’article d’André Racicot cité plus haut, qui date de 2013, soit bien après ce changement, atteste cela dit que bien des journalistes français demeurent fidèles au système phonologique français[6].
Rien n’est simple dans ces questions. Par exemple, si un Russe immigre aux États-Unis, il devient un États-Unien portant officiellement le nom translittéré en anglais. Si on parle de lui en français, il sera logique de garder cette graphie anglaise puisque ce n’est plus de la translittération…
Et pour la Chine?
Pour le mandarin, la question se pose autrement : en effet, la République populaire de Chine a adopté officiellement en 1958 un système de translittération se voulant universel, le pinyin, sans tenir compte de la diversité de nos systèmes phonologiques à nous. L’ONU a emboîté le pas en 1979 et, contrairement à ce qui se passe avec le russe, l’arabe et l’hébreu, la pression est forte pour respecter la volonté des Chinois. C’est ce qui fait que Pékin s’appelle maintenant Beijing et que Lao Tseu se balade dorénavant sous le doux nom de Lao Zi.
L’argument pour l’adoption d’un système universel est double : d’une part, il simplifierait les communications internationales par l’adoption d’une graphie unique, et d’autre part ce serait aux Chinois de décider comment leurs mots doivent être translittérés dans les langues étrangères. On est toutefois en droit d’opposer un regard critique à ces arguments. D’abord, l’universalisation de la graphie, je veux bien, mais de toute façon, j’ai beau écrire Beijing au lieu de Pékin, puisque j’écris en français, tous les mots autour sont en français et s’adressent à des francophones. C’est le principe même de l’existence de langues différentes dans le monde. Donc, pourquoi ne pas utiliser un mot français dans un texte français?
Pour ce qui est de la volonté des Chinois, j’admets que je ne fais pas le poids pour m’opposer à l’Empire du Milieu, mais je lui soumets respectueusement que ma langue m’appartient. Personnellement, je trouve plus lisible et intelligible un mot comme Canton que son équivalent Guangzhou, et si jamais je veux apprendre le mandarin, je ferai l’effort nécessaire pour y arriver, mais pour le moment je m’exprime en français. En mandarin, la France s’appelle fǎ guó, l’Espagne xī bān yá, le Mexique mò xī gē, le Canada jiā ná dà et le Québec kuí běi kè[7]. Je n’en veux pas aux Chinois, je leur reconnais le droit d’adapter la prononciation des noms de noms pays à leur système linguistique… et phonatoire.
Si encore, avec le pinyin, on se rapprochait de la prononciation de l’original… Mais on se heurte au même problème qu’avec les autres langues : de toute façon, on ne prononcera pas une même graphie de la même manière selon qu’on est francophone, anglophone ou hispanophone… donc on ne le prononcera sûrement pas à la chinoise! Le sinologue Jean François Billeter note d’ailleurs que « [l]e système pinyin […] est imprononçable pour un lecteur français qui ne l’a pas spécialement étudié »[8]. Et quand il dit « imprononçable », il faut savoir jusqu’à quel point! En pinyin, le q se prononce tch (ou ts’), le x se prononce quelque part entre le s et le ch, le zh se prononce j, le j se prononce ts, le z se prononce dz et le i se prononce eu… de telle sorte que mon Lao Zi d’il y a trois paragraphes ne se prononce pas, ô surprise, lao-zi mais lao-dzeu, comme le suggérait plus efficacement l’ancienne graphie. On peut supposer que le Tseu de Lao Tseu, plus dur que Dzeu, correspond à la prononciation de certaines régions, ou alors que la prononciation réelle se trouve entre les deux. De toute façon, la prononciation du mandarin est à des années-lumière de ce qu’on connaît et peut reproduire en français, avec notamment ses « tons », dont on n’a aucune idée dans notre sphère linguistique, alors l’idée de « respecter la prononciation chinoise » demeure totalement illusoire.
Bref, je suis Pékin.
[1] Nous revenons ici à l’alphabet phonétique international (API) dont nous avons parlé au chapitre 6. Clarifions les choses pour la bonne compréhension de la présente section : dans cet alphabet, le son ou s’écrit [u], le son u s’écrit [y], le son ch s’écrit [ʃ] et le son j s’écrit [ʒ].
[2] André Racicot, « Translittération », sur le blogue Au cœur du français, 7 mai 2022, https://andreracicot.ca/translitteration/, consulté le 8 mai 2025.
[3] Alix Renaud, Mots étrangers, mots français, éd. Varia, Montréal, 2006, p. 15. Italique dans le texte.
[4] Wikipédia, Transcription du russe en français, consulté le 8 mai 2025.
[5] Loc. cit.
[6] André Racicot, op. cit.
[7] Les trois premiers noms viennent du site 130 pays en chinois, https://chinoistips.com/pays-en-chinois/. Pour Québec, l’information m’a été donnée par l’IA Perplexity, qui n’a pu me fournir de sources mais m’a garanti que l’information était exacte…
[8] Jean François Billeter, Quatre essais sur la traduction, éd. Allia, 2023, pp. 8-9.
-
Traduire autour du monde

Qui n’a pas rêvé de travailler à l’étranger ? Annik LaRoche Bradford, elle, a décidé de passer du rêve à la réalité. Grande voyageuse, la propriétaire d’Accent Communication est partie, en juin dernier, faire le « tour du monde » avec toute sa petite famille.
Armée de son portable et de sa fidèle clientèle — qu’elle avait bien préparée — elle a loué sa maison à Blainville, vendu sa voiture et bouclé 6 mois de bagages pour elle, son mari, et ses 2 enfants avant de mettre le cap sur l’Europe, première étape d’un périple dont tout n’est pas encore décidé.
Je lui ai rendu visite au mois d’août à Chepstow, dans le sud du Pays de Galles, et j’en ai profité pour lui poser les questions qui me trottaient dans la tête.
Annik, qu’est-ce qui t’a motivée à faire le grand saut?
Le voyage a pris racine dans ma tête et celle de mon mari Shane à l’été 2024, alors qu’on gardait la maison d’amis français à Phuket pour deux mois. C’était notre premier voyage de la sorte avec les enfants, et ça nous a fait grand bien de ralentir le rythme quelques semaines, de faire plus de choses ensemble qu’à l’habitude et de vivre une expérience enrichissante en famille. On s’est alors mis à rêver de le refaire à plus long terme. Nos enfants ont 7 et 6 ans, et on réalise à quel point le temps est précieux. Ils sont à l’âge d’être autonomes et curieux, mais pas encore tannés de suivre leurs parents… On s’est dit que c’était maintenant ou jamais! Alors, on a pris l’année pour préparer le tout.
Côté travail, ça se passe comment?
Heureusement, ce n’est pas mon premier voyage du genre. On a voyagé un an et demi avant la naissance de notre fille; je connais donc bien la routine et mes outils sont bien rodés. Mes clients savent que je continue à travailler, même à distance. Ça ne m’a donc jamais causé de problème. C’est le décalage horaire qui me donne plus de fil à retordre. En Europe, ça va encore, mais lorsqu’on était en Thaïlande l’an dernier, j’ai dû faire des rencontres à 23 h, par exemple. Il arrive aussi que mon mari et mes enfants partent pour la journée et que je doive rester derrière pour travailler. Je rate des occasions, c’est certain, mais c’est le compromis à faire pour avoir le style de vie qu’on désire.
Et la famille, ça va?
La famille a vécu beaucoup de changements depuis juin dernier, alors on apprend à s’ajuster, mais à date, tout se passe bien. Mon mari Shane, qui a quitté son emploi pour le voyage, a pris sur lui beaucoup de nouvelles responsabilités, dont celle de faire l’école aux enfants. En gros, on a inversé les rôles traditionnels : je travaille et il s’occupe des enfants, des repas, etc. On fonctionne maintenant avec un seul salaire, alors on doit faire attention à nos finances, surtout au Royaume-Uni, où la valeur du dollar canadien est très faible. Pour baisser nos coûts au minimum, on a fait le choix de garder des maisons pour avoir accès à une cuisine, une laveuse et parfois même une voiture. Toute la famille doit donc apprendre à composer avec une nouvelle réalité et un nouvel horaire, mais le jeu en vaut la chandelle. On est ensemble tous les jours, on a le temps de voir nos enfants grandir, et on découvre de nouveaux coins de pays. C’était le but!
Qu’as-tu à dire à ceux et celles qui voudraient faire comme toi?
Faites-le (mais faites-le bien)! Il y a beaucoup de choses à prévoir, de questions à poser et de solutions à mettre en place avant de partir pour éviter les mauvaises surprises. Mais ça se fait de façon progressive, une étape à la fois. Tout finit par se placer.
Il faut aussi accepter les sacrifices qui viennent avec un tel voyage – ce n’est pas tout simple et ce n’est pas tout rose. Il faut être réaliste et savoir se discipliner. Je ne suis pas en vacances, je ne suis pas en voyage; je vis ma vie à l’étranger pendant un an, c’est différent. Certaines journées sont excitantes, d’autres sont plutôt « ordinaires ». Et ça me va comme ça. C’est pareil à la maison! On ne peut pas déployer la même énergie au quotidien que pendant un voyage de deux semaines. Mais, entre ces journées « ordinaires », on vit des expériences mémorables qui justifient les efforts. Je partage mon expérience avec plaisir avec toute personne qui aimerait se lancer dans l’aventure, en espérant que je puisse lui épargner des erreurs en cours de route.
Merci Annik de nous faire voyager!
Je dois avouer que je suis un peu jalouse… Mais je me dis qu’au moins, j’aurai la chance d’aller voir mon amie dans des pays que je n’ai pas encore visités! D’ici là, je continuerai de vous donner périodiquement des nouvelles d’Annik. Déjà, je peux vous annoncer qu’elle prépare une formation sur la traduction touristique pour Magistrad. Demeurez à l’affût pour tout savoir!
-
Continuez à étudier et à vous former, nom de Dieu!

Bruno Colmant
L’IA est, sans aucun doute, une prodigieuse révolution industrielle, et je ne sais même pas si le mot industriel est adapté puisque cette révolution complète les capacités cognitives.
Mais il y a un danger : c’est de confondre l’accès à l’information et au raisonnement avec la curiosité, la structuration déductive, l’apprentissage des lignes du temps, des interactions, des juxtapositions d’idées, souvent intuitives et inductives. Rien ne remplacera la petite voix intérieure, la capacité à comprendre les situations et les hommes, à moins d’entrer dans un monde de robots.
Et je pense qu’aujourd’hui, plus que jamais, il faut étudier, suivre des formations, y compris des micro-formations ciblées et régulières. Cette exigence de soi, loin d’être une contrainte, est une source profonde de satisfaction. Car elle procure la joie inégalée de surmonter l’inconnu, de défricher de nouveaux territoires de pensée, et, in fine, d’accéder à une véritable indépendance intellectuelle et à une autonomie de jugement. Il s’agit de ne pas tomber dans le piège de croire qu’une machine sera notre remplaçant, dans un bizarre transhumanisme.
Car, quand on y réfléchit, partant d’un monde comme le mien, où la seule source d’information était des livres et les lectures imposées, sans le foisonnement de médias et l’accès à l’universalité des connaissances, nous avons tous un choix : se laisser porter par les réseaux sociaux et s’enfermer dans des flux d’informations manipulées et disparates, ou bien se former, rigoureusement, scrupuleusement, grâce à ces mêmes moyens d’information, gratuits ou presque, accessibles et qui nous donnent la chance de pouvoir accéder au savoir des plus grands penseurs, d’exercer notre esprit critique et de forger notre propre opinion, socle de toute indépendance de pensée. Je pense aux podcasts, aux livres, aux journaux, bref à tout ce qui contribue à la construction de tout individu qui ne cède pas son destin à des machines : la culture générale.
Continuez à étudier et à vous former, nom de Dieu!
Bruno Colmant est membre de l’Académie royale de Belgique. Cet article est tiré de son Bloc-notes, avec son aimable autorisation.
-
Limitations of Neural Machine Translation

By Joachim Lépine, M. Ed., C. Tr.
State of play
Today’s neural machine translation engines are impressive, especially at first glance, and they have unquestionably improved in recent years.
I personally had to change several NMT revision exercises in my workshops within the last year because the NMT engine had improved and managed to sidestep several errors produced by the same engine just a few years earlier!
Limitations
That being said, they lack the sensitivity and nuanced understanding that only a human translator can bring.
These engines do not « understand » the text in any meaningful way—for all their mystique and sophistication, they are blind to the subtleties of the situation, the intent behind the message, and the cultural sensitivities and regionalisms that color language. Not to mention the subtext, i.e., the text « between the lines » that writers routinely expect a skilled translator to spot, grasp, and convey.
In spite of the constant barrage of « tech bro » marketing announcing that the « problem » of language and translation has been solved, this prognostication just hasn’t materialized. NMT results are frequently laughable (and even farcical).
The fact is, NMT makes mistakes, so translators have to carefully review every word of the output. An NMT translation can never be fully trusted.
Moreover, machines often « hallucinate » to appear more idiomatic, bypassing and skipping elements they do not understand, and they never ask questions to make sure they’ve understood the intent behind the text. This goes against their fundamental programming: NMT engines are unable to ask questions and LLMs are programmed to sound authoritative even when they have no idea what they’re talking about.
It’s also worth mentioning that poring over a machine-made mess isn’t what the vast majority of translators signed up for. It can be demotivating and even outright depressing. Some translators have left the profession over NMT, and at least anecdotally, many more seem to be jumping ship today in the era of GenAI.
Impact on idiom
One of the most significant challenges of machine translation is idiomaticity. Natural, fluid expression requires deep contextual sensitivity, professional and stylistic judgment, and cultural mastery—qualities that today’s neural machine translation engines lack entirely.
Instead, NMT tends to reinforce non-idiomatic patterns it has frequently encountered, especially those from low-quality materials. Garbage in, garbage out. This can lead to a loss of tone and style; for example, a slogan or motto may be translated with the right words but miss the rhythm, style, or impact of the original.
So, is NMT worth using?
There’s no one-size-fits-all answer; it depends.
In the best of cases, for more routine types of texts, NMT can alleviate the drudgery of starting from scratch. This means less typing and mental exhaustion for the translator. And it turns out that many translators prefer working this way. I personally would not go back to typing out every letter of every word from scratch for most of my translations—especially things like policies and administrative forms.
Incidentally, though, like many translators, I’m receiving fewer of those kinds of texts to translate these days. AI is increasingly obviating the need for more general and boilerplate (« mid-market ») translations.
In the worst of cases, NMT should be avoided altogether since it will not only make the translator’s work longer and more arduous, but yield a poorer text, influenced by a bland, cookie-cutter NMT translation that will leave readers cold. This is especially true at the sentence level, since NMT will almost never significantly change the sentence structure, especially when used inside a translation memory environment (where it will only suggest one translation—the « most likely » one).
The role of translators in the near future
Given these limitations, our role is more crucial than ever. Tomorrow’s translators will need to keep bridging the gap between languages and cultures in order to achieve measurable outcomes and avoid reputational, physical, and financial damage. And they will need to emphasize these things in their marketing so clients understand their value (in a world of “one-click everything”). Interested readers can consult my book, AI Resilient, for down-to-earth tips to help them in this regard.
We will need to work alongside technology, using it as a tool rather than as a crutch, to enhance our work and make sure that the richness of language never gets lost.
The same could be said about writers, by the way.
And here we come up against a limitation of language: When someone says they are translating or writing « with » AI, what does that even mean today? Are they revising a machine draft, or are they consulting AI for inspiration or for tweaks? Those are completely different use cases.
We are going to need a new lexicon in the age of AI. And we are going to need new guideposts and frameworks. Perhaps, as language professionals, we are exactly the right people to tackle this challenge.
Looking ahead
In conclusion, while machine translation continues to evolve, there is zero indication that it can replace the human touch (although it may be able to take care of some routine texts with minimal editing).
As we look to the future, we probably need to accept that in most cases, translation, like writing, is predominantly going to be done « with » AI.
It’s going to be important in this brave new world to explore what « with » means. We may need to create some permutations of “with.”
It is a truism that AI makes a great servant but a terrible master. Tools and workflows that support language professionals are key to handling ever-growing translation volumes. Tools and workflows that try to replace humans or make them an afterthought will only harm clients’ interests, and should be roundly condemned.
-
Le sous-titrage : plus qu’une question d’outils

Dans le cadre de sa série « Portraits de formateurs et de formatrices », Magistrad discute de sous-titrage avec Laurence Jay-Rayon Ibrahim Aibo, traductrice agréée, polyglotte, interprète, docteure, chercheuse et enseignante en traduction et auteure du livre The Politics of Translating Sound Motifs in African Fiction.
Bonjour Laurence! Ton parcours professionnel est des plus impressionnants! Tu donnes notamment le cours Initiation au sous-titrage pour Magistrad. Peux-tu nous dire d’où vient ton intérêt pour ce sujet?
Je suis cinéphile, c’est sans doute ce qui m’a incitée au départ à me former en traduction audiovisuelle. À mon sens, le sous-titrage est une forme de « tradinterprétation », qui participe tant de la traduction que de l’interprétation.
Qu’est-ce qui distingue ce type de traduction?
La reformulation est plus importante qu’en traduction « classique » (si tant est que cette catégorie existe), ce qui rapproche le sous-titrage de l’interprétation. On doit s’appuyer sur l’image et la dynamique situationnelle (encore un clin d’œil à l’interprétation) pour pouvoir condenser l’information entendue. Bref, c’est une activité stimulante, qui relève parfois du casse-tête.
Quels sont, selon toi, les défis particuliers du sous-titrage?
La vidéo en tant que média a connu une explosion phénoménale. Cependant – et c’est assez paradoxal –, la qualité des sous-titres a baissé petit à petit (tout le monde s’est improvisé sous-titreur/adaptateur ou sous-titreuse/adaptatrice) et l’accent s’est progressivement déplacé vers les outils techniques. Aujourd’hui, on trouve ainsi une pléthore de formations aux outils ou aux plateformes, mais beaucoup moins de formations aux principes et à l’art du sous-titrage. Les questions d’ordre technique font bien entendu partie de cette discipline, mais celle-ci nécessite avant tout une excellente compréhension de l’audiovisuel.
À l’heure actuelle, l’ennemi numéro un, c’est la perception erronée, du côté du public (par manque de connaissances sur ce sujet) et des géants du domaine (par appât du gain), de ce que peuvent faire les outils artificiels.
Est-ce que ces outils ont tout de même une certaine utilité?
On peut bien entendu gagner du temps à certaines étapes en y faisant appel, mais il n’en reste pas moins que c’est au milieu professionnel (personnes formées et expérimentées) de décider des outils à utiliser – à quels moments et pour quelles tâches. L’art de la reformulation et de la condensation du message en fonction d’éléments contextuels et à partir de contraintes d’espace et de temps ne doit pas être confié à la machine.
Penses-tu que les jeunes qui s’orientent vers cette pratique ont un avenir prometteur?
Les débouchés sont énormes, car l’utilisation de la vidéo continue à se développer. Tout le monde y fait appel : entreprises privées, ONG, pouvoirs publics. Bref, on a besoin de personnes qualifiées pour faire du sous-titrage interlinguistique, mais il faudra pour cela rectifier cette question de perception évoquée ci-dessus (laquelle n’est pas propre au sous-titrage, puisqu’elle concerne également les activités de traduction et d’interprétation).
Voilà qui nous rassure! Merci, Laurence, pour cet aperçu fort intéressant, et au plaisir de discuter de nouveau avec toi. La prochaine fois, nous pourrions aborder les défis de La traduction en ressources humaines, une autre de tes passions qui s’est transformée en formation…
-
Traduire « inclusif » en ressources humaines

Laurence Jay-Rayon Ibrahim Aibo, Ph. D.
Bonjour à toustes !
Si la lecture de cette formule de politesse n’a provoqué chez vous ni embolie gazeuse ni violente allergie, vous pouvez continuer à lire le reste de cet article. Âmes résistantes au changement, s’abstenir1.
La représentativité constitue un enjeu majeur en ressources humaines. Que l’on traduise une offre d’emploi, une politique d’entreprise ou une nouvelle directive, il s’agit de permettre à tout le monde (et non « à chacun », tournure genrée) de se reconnaître et de se projeter dans un texte. À une époque où les entreprises investissent des sommes considérables dans leur image et veillent à assurer une meilleure parité des genres sur leurs visuels, il est de bon ton — et grand temps — que les textes que nous traduisons soient à la hauteur.
« Aujourd’hui, une offre d’emploi rédigée uniquement avec un masculin générique (par exemple, informaticien recherché) pourrait être perçue comme sexiste. Un texte qui s’adresse à un lectorat mixte, ou qui concerne des hommes et des femmes, peut être rédigé de manière à ce que les deux sexes s’y trouvent équitablement représentés. » (Druide. « Rédaction inclusive ». Points de langue. Avril 2020.)
Ceci n’est
pasplus une stratégie« Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. »
Bien entendu, la foudre ne s’abattra pas sur vous si vous utilisez encore cette formule ô combien pratique (« je n’ai pas à m’embêter et puis on a toujours fait comme ça2! »), mais, progressivement, votre clientèle exigera de vous, spécialistes de la langue, des solutions. « En français, l’identité de genre des personnes et le genre grammatical, féminin ou masculin, sont étroitement associés. » (OQLF, Banque de dépannage linguistique)
Force est de constater que toutes les régions francophones n’en sont pas au même stade de réflexion. Le Québec a, très tôt, commencé à se pencher sérieusement sur le sujet. Il n’est donc pas surprenant de trouver une pléthore de recommandations, de guides et de suggestions linguistiques en matière de rédaction inclusive au Québec. En France, l’indifférence et la résistance des autorités linguistiques et de certaines institutions ont considérablement ralenti la créativité linguistique. Aujourd’hui, cependant, personne ne veut être en reste et la plupart des pays francophones d’Europe ont emboîté le pas au Québec, à des degrés différents.
Dans ce qui suit, je présenterai quelques stratégies toutes simples pouvant être appliquées aux textes de ressources humaines que nous traduisons de l’anglais au français, langue qui marque plus fortement le genre que l’anglais et dont l’évolution se heurte à des résistances de tous genres. Partant du principe que la traduction est une forme de rédaction contrainte, les mots « rédaction » et « rédiger » utilisés ci‑dessous engloberont automatiquement l’activité de traduction. Je précise que ce billet n’a aucune prétention à effectuer un recensement exhaustif de toutes les ressources des régions francophones évoquées.
Le Petit Robert en ligne précise que l’écriture inclusive s’efforce « d’assurer une représentation égale des hommes et des femmes dans les textes. » Aussitôt dit, aussitôt fait ? Pas si vite, pas si simple. Féminiser un texte consiste à utiliser des formes féminines en le rédigeant, ce qui peut passer par la féminisation des noms de professions (informaticien ou informaticienne, informaticien(-ne), informaticien·ne) ou par le choix de certaines formes grammaticales (tous et toutes). On reviendra sur le choix des formes à notre disposition dans quelques instants. L’écriture épicène, c’est-à-dire qui ne varie pas en fonction du genre, constitue l’une des autres stratégies pouvant être mises en œuvre. « Le nom journaliste, l’adjectif pauvre et le pronom je sont épicènes. » (Dictionnaire Usito). La prolifération récente des guides et manuels d’écriture épicène montre que cette stratégie est aujourd’hui recommandée partout et par tout le monde, car elle permet d’alléger le texte sans imposer de changement et, par conséquent, sans provoquer de résistance audit changement.
Examinons quelques stratégies de rédaction équitable, puis quelques exemples de stratégies de rédaction épicène.
Doublets
- Les conseillers et les conseillères
Alternance de désignations à caractère dit « générique »
- Utiliser à tour de rôle « infirmier » et « infirmière »
Accord de proximité
- Les rédacteurs et rédactrices sont préparées.
- Les rédactrices et rédacteurs sont préparés.
Notons au passage que l’accord de proximité est encore loin de faire l’unanimité et qu’il est encore difficile, dans le milieu de la traduction, de le proposer à sa clientèle, bien que la règle d’accord du masculin générique n’ait pas toujours existé. En effet, l’accord de proximité a été appliqué dans la langue française pendant plusieurs siècles.
L’utilisation de la troncation, encore appelée doublets abrégés, constitue une autre stratégie d’équité linguistique, dont les formes préconisées varient en fonction des sphères géographiques et des préférences personnelles. L’auteur·e de l’article « Rédaction inclusive » publié dans Points de langue en avril 2020 conseille de les réserver « à des contextes exceptionnels où l’espace manque (tableaux, formulaires) et où aucune solution de rechange n’est possible », et propose un classement des formes de troncation en fonction de leur « nuisance croissante », dont voici la distribution :
« adjoint(e)s
résident·e·s
salarié[é]s
plombier/ière/s
réviseur-euse-s
étudiantEs
lecteur.trice.s »La troncation avec point médian, comme dans « les candidat·e·s » ou « les candidat·es » (notons que la seconde formule, avec point médian unique où la marque du pluriel est accolée à la marque du féminin, semble être aujourd’hui davantage préconisée que la première), est beaucoup utilisée en sciences sociales et dans la presse française. Les doublets abrégés, comme dans « autorisation du (de la) directeur(‑trice) » ou « signature du [de la] sauveteur[-euse] », sont préconisés par l’Office québécois de la langue française (OQLF). Le Bureau de la traduction, au Canada, déconseille fortement tout signe de troncation, position assez problématique lorsque l’on traduit un texte avec de fortes contraintes spatiales, tel qu’un formulaire, et que des doublets complets ou une tournure épicène sont impossibles. Avant d’aller plus loin, précisons que les partisans du point médian font valoir que ce signe typographique était disponible, au sens de « pas encore pris », tandis que le point traditionnel marque la fin d’une phrase, que les parenthèses indiquent un propos secondaire (connotation problématique lorsque l’objectif désiré est l’équité), que la barre oblique fait référence à la division et que le tiret est déjà utilisé pour le trait d’union (dont la connotation est cependant nettement moins problématique que les parenthèses).
Qui fait quoi ?
Au Québec, la plupart des universités publient des guides sur la féminisation et sur la rédaction inclusive. L’Office québécois de la langue française, le Bureau de la traduction et Druide, l’entreprise de services linguistiques qui est à l’origine du logiciel Antidote, mais aussi du blogue Points de langue, offrent une pléthore de ressources, dont certaines figurent dans la liste de références qui suit cet article.
En France, les multiples résistances de l’Académie française ont considérablement retardé l’entérinement de la féminisation des noms de métier. L’écriture épicène et la troncation avec point médian sont aujourd’hui préconisées par certains organismes publics, dont le Haut Conseil à l’Égalité, qui publie un guide pratique intitulé Pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Le point médian semble être rentré dans les mœurs de certaines rédactions et l’agence de communication Mots-clés publie un Manuel d’écriture inclusive recommandé dans certaines universités françaises.
En Suisse, des efforts conséquents ont été déployés en la matière, notamment par l’Université de Genève (Guide romand d’aide à la rédaction administrative et législative épicène) et par le Canton de Vaud (« Exemples et conseils pour la rédaction épicène »).
Quelques solutions toutes simples en ressources humaines
On trouvera ci-dessous quelques suggestions de traductions neutres ou épicènes propres au domaine des ressources humaines :
- Le personnel, le personnel salarié (employees)
- Cadre, direction, responsable, supérieur·e, dirigeant·e (Manager/management/supervisor)
- La clientèle (clients)
- La main-d’œuvre (workers, workforce)
- L’effectif (workforce)
- Les collègues (coworkers)
- Le corps enseignant (professors)
- Son ou sa supérieur·e (their supervisor)
- Son ou sa responsable (their supervisor)
- La personne
- La personne salariée (employee)
- La nouvelle recrue (new employee)
La personne, cette formidable désignation
Le mot épicène « personne » constitue une stratégie d’écriture aussi simple qu’efficace, comme l’illustrent les quelques exemples qui suivent.
- Droits de la personne (Droits de l’
homme)
Exemples d’utilisation du mot « personne » au Québec et au Canada :
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (QC)
- Charte des droits et libertés de la personne (QC)
- Tribunal des droits de la personne (QC)
- Loi canadienne sur les droits de la personne (CA)
Cet extrait de la Trousse d’accueil et d’intégration en emploi des libraires publiée par le Conseil québécois des ressources humaines en culture fait une belle démonstration de la simplicité d’utilisation de l’écriture épicène en ressources humaines3.
« On peut saisir la culture organisationnelle d’une librairie à partir du choix du fonds de livres, des livres qui sont mis en évidence, des caractéristiques des personnes sélectionnées pour y travailler, de la nature des conseils prodigués à la clientèle. »
- Toute entreprise a avantage à définir de manière précise les conditions de travail des personnes qu’elle embauche.
- Conseiller la clientèle sur des choix possibles de lecture et répondre à des demandes particulières. Écouter attentivement la demande formulée par la personne.
- Soumettre à la personne responsable des achats dans la librairie la liste des livres à acheter.
- L’employeur4 peut effectuer une retenue sur le salaire si elle est consécutive à une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, un décret ou un régime de retraite à adhésion obligatoire. Il doit obtenir un consentement écrit de la part de la personne salariée pour toute autre retenue. »
L’utilisation de noms collectifs (clientèle, auditoire), du nom des services d’une entreprise (la direction, la comptabilité, le service du personnel) ou de mots épicènes (spécialiste, bénévole, collègue) permet de facilement dégenrer le texte. On retrouve d’ailleurs souvent ces stratégies d’écriture dans la presse de langue française, qui évoque « le milieu de la traduction », « le patronat », « la rédaction », etc.
Le Canton de Vaud, dans son excellent « Exemples et conseils pour la rédaction épicène », propose quelques trucs fort astucieux en matière de tournures non personnelles. Il s’agit ici de mettre l’accent non pas sur la personne en elle-même, mais plutôt sur son autorité, sa compétence, son activité ou son état, éléments d’ailleurs beaucoup plus pertinents que le genre en milieu de travail.
- Date de naissance (plutôt que « Né/Née le… »).
- Le tribunal fixe les sanctions de sorte que… (plutôt que « Le juge fixe »).
- Les secours sont arrivés (plutôt que « Les sauveteurs… »).
- En cas de blessure, ne pas laisser l’élève sans surveillance (plutôt que « ne pas laisser l’élève blessé seul »).
Le Manuel d’écriture inclusive de l’agence Mots-Clés illustre les possibles à partir de la déclinaison suivante :
Formulation genrée initiale :
- « Merci à tous d’être à leurs côtés. »
Formulation inclusive fléchie :
- « Merci à tous et à toutes d’être à leurs côtés. »
Formulations inclusives épicènes :
- « Merci d’être à leurs côtés5. »
- « Merci à vous d’être à leurs côtés. »
- « Merci à tout le monde d’être à leurs côtés. »
- « Merci à l’ensemble de nos collègues d’être à leurs côtés. »
Au-delà des tournures ci-dessus, assorties de degrés d’économie variables, les spécialistes de la langue que nous sommes disposent d’une autre tournure, très économique, mais nouvelle. Les personnes présentant une résistance naturelle au changement sont susceptibles de sursauter. Cependant, posons‑nous en toute honnêteté la question essentielle : qui ne comprend pas le sens de « Merci à toustes »?
Il en va de même pour les pronoms non binaires « iel » et « iels », qui sont les formes les plus fréquemment utilisées pour traduire en français le « they » non binaire, même si quelques variations orthographiques sont parfois observées (« ielle » et « ielles »). Bien que ces pronoms n’aient fait leur apparition que tout récemment, ils se comprennent parfaitement en contexte.
Progressivement, les textes que nous traduirons en ressources humaines reflèteront une volonté d’intégration de toutes les personnes, au-delà du masculin générique et du binaire traditionnel. La langue doit suivre, y compris la nôtre, et elle suit déjà. Il suffit d’observer son usage actuel pour s’en rendre compte. Il est donc important de pouvoir être force de proposition vis-à-vis de notre clientèle. Par ailleurs, en mettant en avant cette compétence, nous nous dotons d’un atout supplémentaire de taille, qui ajoute de la valeur aux services que nous offrons.
Merci à toustes de votre attention.
- Cet article est la reprise d’un billet publié le 17 février 2021 dans À propos, l’infolettre de la French Language Division de l’American Translators Association. ↩︎
- Oui, la terre était plate aussi pendant longtemps. ↩︎
- Caractères gras ajoutés par l’auteure. ↩︎
- « Employeur » est ici utilisé au sens de personne morale (entité juridique) et non de personne physique. ↩︎
- Palme de la tournure économique. ↩︎
-
Mot de la présidente de Magistrad

L’an dernier à pareille date, mon associé et moi, tout comme François Lavallée, fondateur de Magistrad, et son associé, étions dans la fébrilité des dernières tractations qui devaient mener à notre entente de vente des actions de Magistrad à Traductions Hermès, cabinet dont je suis copropriétaire. Quels apprentissages cette aventure nous a apportés!
Une année a passé, et depuis, j’ai fait mes armes pour piloter la solide entreprise que nous avons acquise. Avant même d’en tenir les rênes, Magistrad m’avait toujours remplie de fierté, moi qui avais été depuis les tout débuts une fidèle participante aux formations proposées.
Grâce à la fabuleuse équipe montée par François, à la rigueur des formateurs et formatrices et à l’enthousiasme de Caroline Tremblay, venue nous épauler pour l’organisation des formations, le bilan de la dernière année a de quoi faire sourire : une multiplication de l’offre et des formules, une tournée européenne pour notre traducteur averti préféré, le retour de formations en présentiel avec l’excellent Marc Lambert, une belle visibilité aux derniers Jeux de la traduction et au congrès de l’OTTIAQ… Et bien sûr, votre présence à vous à nos activités, collègues de tous horizons et de partout dans le monde!
Pour la nouvelle année, les projets sont loin de manquer! Toujours dans l’idée de répondre aux besoins des langagières et langagiers, déjà, Magistrad s’est dotée de sa propre collection de thés favorisant l’apprentissage et la concentration et a mitonné un calendrier général des formations dans notre domaine. Nous mijotons également de nouvelles formules de formation, souhaitons explorer la tenue d’activités en format hybride, comptons développer l’offre asynchrone (formations pré-enregistrées), réfléchissons à de nouveaux services potentiels (ex. : mentorat et accompagnement), et avons hâte de susciter de nouvelles occasions de rencontre et d’échange.
Sans nul doute, tout comme 2024, 2025 se profile pour être une belle année! Nous espérons que vous serez au rendez-vous pour la vivre avec nous, et nous vous remercions de votre fidélité à Magistrad!
Mélodie Benoit-Lamarre
Présidente et formatrice -
Du plaisir de se retrouver entre collègues

Comme vous le savez peut-être, j’ai rejoint François Lavallée pour la partie bruxelloise de sa tournée européenne. Invitée à séjourner chez une amie inscrite à la formation « Libérez le génie de la langue! » le 30 octobre dans la capitale belge, je n’ai pu résister à l’envie de retourner dans cette magnifique ville (que je n’avais pas visitée depuis mil neuf cent nonante-huit, comme on dit là-bas). En bon québécois, ça faisait un bail!
Tant qu’à être là, j’ai aussi accompagné notre ami le traducteur averti à l’OTAN, où il présentait son fameux safari-photo – une conférence de trois heures super intéressante – où le maître commente différentes affiches pour faire ressortir le génie propre à chaque langue… ou parfois le traduidu résultant d’une approche administrative de la traduction (à ne pas confondre avec une approche de la traduction administrative… idiomatique! ;–).
Dire que j’ai été impressionnée par l’OTAN est un euphémisme. Le bâtiment qui abrite le nouveau siège de l’organisation d’abord : blanc, immense, qui brille comme un sou neuf sous le soleil automnal (lequel a accompagné pratiquement tout mon périple). Les gardes armés, devant ledit immeuble, qui expédient manu militari (pas pu m’empêcher) toute personne qui n’a pas d’affaire là. Les hauts gradés en uniformes, avec leurs galons, leurs médailles et autres décorations. La procédure d’entrée, formelle à souhait, détecteur de métal, contrôle des sacs et des appareils électroniques, et réquisition des passeports compris. Le badge, qu’on ne remet qu’après l’arrivée et la signature de la personne qui nous accompagne. La salle, qu’on atteint après avoir gravi un escalier majestueux, où trône une immense table de réunion entourée de sièges, dotés de deux écrans de projection et de tout le nécessaire pour l’interprétation simultanée. Et enfin, l’équipe du service de traduction : 40 traductrices et traducteurs – uniquement vers le français! – habillés en jeans troués (pas tous, pas tous!), sympas, accessibles et super contents de nous recevoir.
Voilà donc où je voulais en venir, après avoir tourné autour du pot pendant trois paragraphes.
Cet après-midi-là, comme le lendemain lors de la formation d’une journée, ce qui m’a particulièrement frappé, c’est le plaisir immense que tout le monde, y compris moi, avait de se retrouver entre collègues, en personne, pour apprendre et se perfectionner, oui, mais aussi pour échanger sur mille et un sujets qui touchent la traduction de près, de loin, ou pas pantoute. Ça m’a rappelé avec force et nostalgie qu’avant 2020, on organisait tout plein d’événements en présentiel, comme on dit maintenant, qui se tiennent depuis en distanciel (parallélisme oblige). J’avoue que c’est plus pratique – après tout, ce n’est pas tout le monde qui se déplace en Europe pour participer à deux jours d’activités – mais ça reste quand même moins enrichissant! Alors, on fait un effort et on sort???
Blogue sur la langue et la traduction, alimenté par les formateurs et formatrices de Magistrad