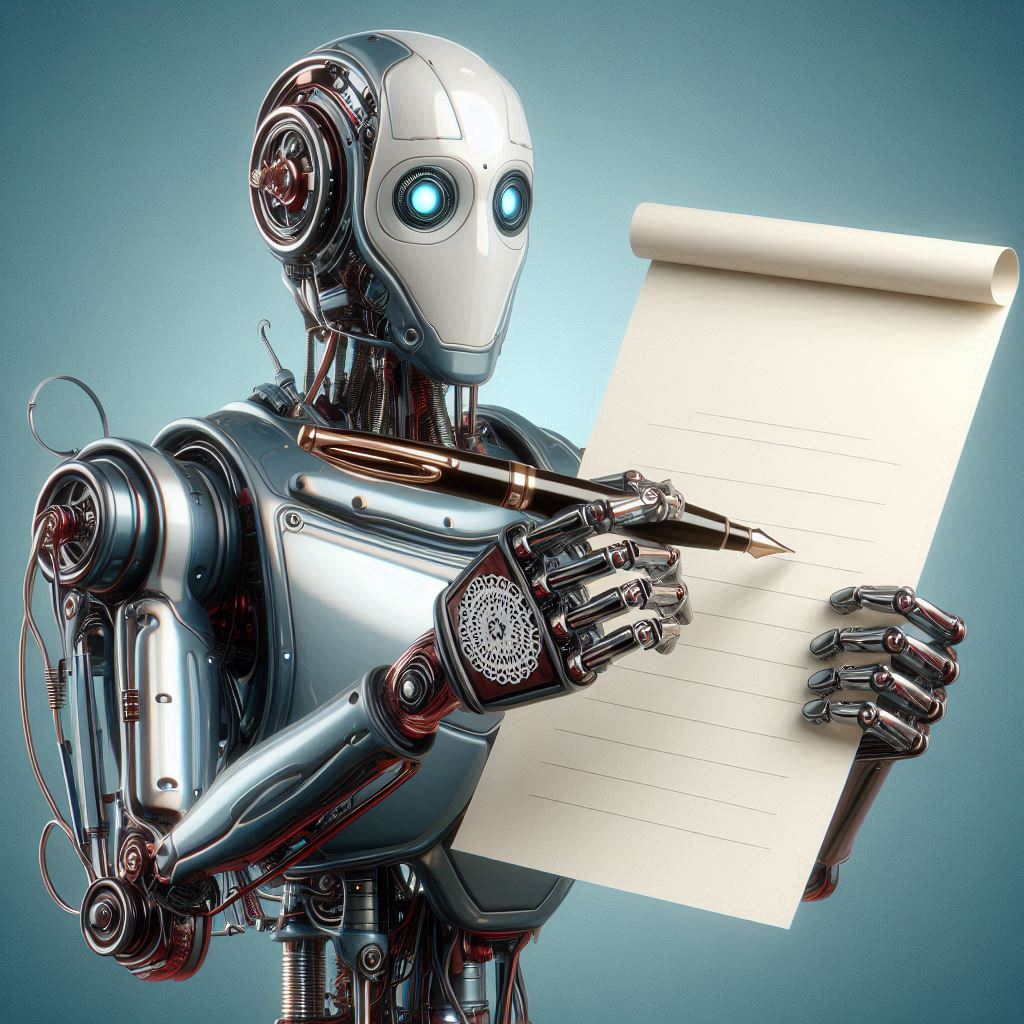-
Ne vous inquiétez pas pour moi : je vais bien!

Mon dernier billet a été écrit à huit jours et à 6 000 kilomètres de celui-ci. Que de choses se sont passées depuis! D’abord l’accueillante et sympathique Matinale de la Société française des traducteurs samedi (45 participants), puis le cours d’un jour sur le thème « Simplifier sans niveler par le bas » lundi (13 participants), suivi du traduel à Paris Cité (devant 14 étudiants allumés) mardi, avant mon départ ferroviaire vers Lyon où je donnerai demain vendredi (le 25 octobre) le cours d’un jour intitulé « Libérez le génie de la langue! » (15 participants).
« Mais-mais-mais…! direz-vous, ça veut dire que tu étais libre toute la journée dimanche et encore aujourd’hui jeudi, gros chanceux/veinard? » Eh bien… oui et non! On ne soupçonne pas tout le travail qui doit se faire entre les lignes lors de ces tournées… Communiquer avec les organisateurs, avec les participants, réviser les contenus une nième fois, les peaufiner, les adapter à l’auditoire, se familiariser avec les lieux, régler les problèmes techniques (mon adaptateur USBC-HDMI s’avère lamentablement inopérant), rendre compte des événements à l’équipe restée au camp de base (et qui se lève affreusement tard d’un point de vue européen), alimenter les réseaux sociaux… Je compte encore visiter le Vieux Lyon aujourd’hui, mais on est déjà au milieu de l’après-midi, et jusqu’ici, j’ai passé toute la journée cloué à l’ordi dans ma chambre d’hôtel! Et encore, j’ai la chance de pouvoir compter sur la division « agence de voyage » de Magistrad en la personne de Caroline Tremblay!
Ça va mieux, François?
Je vous ai laissés, dans mon dernier billet, sur le stress que m’occasionne ce genre de voyage, et les plus assidus auront constaté également, sur les réseaux sociaux, qu’à l’épicondylite dextro-latérale et à la tendinite sénestro-polliciale déjà présentes à mon départ de Québec s’est joyeusement greffée une aphonie quasito-totale juste à temps pour la formation de lundi et le traduel de mardi.
Alors je vous dois bien un petit billet pour rassurer les plus émotifs d’entre vous : je vais bien. Très bien, même. Après tout, ne suis-je pas en train de me promener en Europe pour rencontrer des confrères et consœurs qui m’accueillent à bras ouverts? D’autant plus que, ce n’est un secret pour personne, j’adore la France et les Français (ce qui n’enlève rien aux Belges, nos compagnons d’armes face à la force de frappe de leurs voisins du sud). Et, pardonnez le cliché, mais je ne me lasse pas des croissants.
Le dernier billet a d’ailleurs eu un effet thérapeutique pour moi : dès qu’il fut publié, l’angoisse a laissé place presque entièrement à l’excitation du départ. Que voulez-vous, en digne représentant de l’espèce Homo sapiens, j’ai d’abord besoin d’être entendu!
Un TGV, c’est vite, mais c’est long
Il reste que, en déplacement, je suis une bibitte rare dans le monde de la traduction. Les traducteurs sont généralement de grands voyageurs, et particulièrement ceux que je fréquente, souvent des formateurs, des professeurs ou des responsables d’associations. Moi, ayant grandi et passé toute ma vie dans l’humble cocon d’une capitale provinciale en tentant de concilier tant bien que mal ma passion professionnelle et l’amour de ma famille, je suis encore un enfant devant un billet de train. Tenez, par exemple, vous le saviez, vous, qu’il y avait une différence entre une rame et une voiture dans un TGV? Je suis sûr que oui. Pas moi. Ayant un billet pour la voiture 3, hier, il a donc fallu que je me rende jusqu’au bout du train (et c’est long, un TGV) pour me rendre compte qu’il fallait que je surveille non pas les gros chiffres peints sur les voitures, mais les petits écrans numériques dont ils sont flanqués. Mais je me connaissais assez pour savoir que je devais arriver tôt à la gare, alors j’ai eu tout le temps voulu pour revenir sur mes pas (et constater que les TGV sont aussi longs dans un sens que dans l’autre).
Il va sans dire que Google Maps est mon ami. Il ne cesse d’ailleurs de m’étonner, allant même jusqu’à m’indiquer laquelle des 15 sorties je dois choisir en descendant du métro Gare de Lyon (qui, logiquement, est à Paris, comme chacun sait). Oh, et j’ai un petit truc à vous communiquer que, pour le coup (ça y est, le français hexagonal me rentre dedans!), vous ne connaissez peut-être pas : lorsque vous donnez à Google Maps un itinéraire à faire à pied, vous n’avez plus besoin de le regarder. Gardez-le dans votre poche et surveillez ses vibrations : long-court-court = tourner à droite dans 20 mètres; court-court-long = tourner à gauche dans 20 mètres.
J’ai ainsi pu crapahuter dans une bonne partie de Lyon, hier, pour me rendre compte que, contrairement aux établissements canadiens, les nettoyeurs (pardon : les pressings) français ne font rien à moins de 48 heures. La France lave peut-être plus blanc, mais le Canada lave plus vite!
À moi Lyon?
Au moment, où j’écris ceci, Lyon me tend les bras, avec un climat beaucoup plus clément que l’Île-de-France (soleil et près de 20° ici, contre pluie et nuages autour de 15° là-bas, grosso modo). Aurai-je le temps d’aller visiter les arènes pour rendre hommage à Blandine, cette jeune esclave chrétienne persécutée par les Romains, que les lions ont miraculeusement épargné en laissant le sale boulot au bourreau, en l’an de grâce 177? L’avenir nous le dira. En attendant, je dois être prêt pour mes Français à moi, ceux avec qui j’explorerai les joies de la technique de la feuille retournée demain.
-
On n’arrête jamais de vivre

François Lavallée nous livre ses états d’âme à 36 heures de son départ pour l’Europe…
Février 2020. Une chape de plomb est sur le point de s’abattre sur la planète, mais personne ne s’en doute. Tout au plus certains citoyens excessivement prudents prennent-ils la peine de laisser les colis arrivant de Chine mijoter quelques jours dans le congélo.
Moi, je pars pour Yellowknife. C’est à 3 000 kilomètres de chez moi, mais je suis parfaitement à l’aise. Depuis une quinzaine d’années, je vais partout, de Halifax à Whitehorse en passant par Regina et Toronto; j’ai ma valise standard, ma liste de vérification, mes petites habitudes… presque comme George Clooney dans Up in the Air. Je suis loin de me douter que c’est mon dernier voyage pour un bon bout. D’ailleurs, je me réjouis d’avance du fait qu’on m’attend en Belgique en mai pour un congrès (qui n’aura jamais lieu).
Faire quoi, à Yellowknife? Oh, la routine : animer des formations de « traduction administrative… idiomatique! » Ce sera la 79e fois que je donnerai mon volet I, tout est bien rodé et j’ai confiance en mon contenu : les commentaires sur ce cours sont invariablement bons depuis les lointaines premières séances…
Bref, en février 2020, sans aller jusqu’à m’endormir sur mes lauriers, je peux dire que tout va bien, que je suis à l’aise dans ce que je fais, que mon niveau de stress est quasi inexistant et, cerise sur le gâteau, que rien de tout cela n’émousse le plaisir bien réel que j’ai à me promener d’un bout à l’autre du pays pour parler traduction avec des confrères et consœurs.
Je dis « d’un bout à l’autre du pays », mais au fil des années, il y a aussi eu trois congrès aux États-Unis, ainsi que deux séminaires « On traduit à » dans l’État de New York et deux autres en Europe. Toujours avec le même plaisir.
Mais cette fois, c’est pas pareil
Alors pourquoi tout ce stress, aujourd’hui, à 36 heures de mon départ pour l’Europe pour faire à peu près la même chose?
La coupure de la COVID qui m’a fait perdre l’habitude du voyage? Le contexte inusité de ce nouveau périple? Sa durée inhabituelle? L’âge?
Sans doute un peu de tout cela. Le fait est que, cette fois-ci, la planification fut longue et relativement stressante.
Sur le plan logistique d’abord : il ne s’agit pas, cette fois, de me rendre en un lieu bien délimité où, après un cocktail d’accueil, je passerai quelques jours en compagnie de collègues et amis dans un cadre bien douillet. Je ferai en effet, en trois semaines, Paris-Lyon-Bruxelles-Arles-Paris. Pas très logique comme itinéraire, je vous le concède, mais c’est le résultat de l’agencement de diverses contraintes, autant du côté de Magistrad que du côté de nos hôtes. Au départ, en bon Nord-Américain que je suis, je comptais louer une voiture. Devant l’incompréhension patente de mes contacts européens, j’ai fini par me résoudre à opter pour le train.
Et c’est ça qui est bizarre : j’ai déjà pris le train à quelques reprises en Europe, mais je ne sais pas pourquoi, la chose m’insécurise aujourd’hui. Peur de me perdre, peur d’être encombré avec mes bagages… L’âge? Peut-être.
Sur le plan du contenu ensuite : quand je suis allé à Yellowknife, je connaissais le contenu de mes cours par cœur. Je ne révisais absolument rien à l’aéroport ou dans l’avion, je vivais zéro stress à l’égard du contenu et de ma capacité à le livrer.
Pour l’Europe, c’est différent : certes, je reprends une bonne partie de mes cours habituels, mais le contexte de prestation sera très différent – et d’abord, je ne suis plus habitué à donner des cours en présentiel! Il faut prévoir le papier, la communication… Et pour le contenu, je connais assez le monde de la traduction pour savoir que l’auditoire européen n’est pas l’auditoire canadien : le contexte d’exercice est différent, et si je connais bien les travers des traducteurs canadiens, je connais moins les penchants des européens… J’ai donc passé les dernières semaines me questionner sur la validité de tel ou tel exemple, à adapter, peaufiner… Pour un type qui a fêté sa première année de retraite il y a deux semaines, j’étais loin du pina colada au bord de la piscine!
Stress, avec ou sans détresse?
Le plus gros stress que j’aie connu comme conférencier dans ma vie, c’était en 2008, la première fois où je suis allé au congrès de l’American Translators Association, à Orlando, à l’invitation des organisateurs. J’en ai passé des nuits blanches à me demander : « Mais que vais-je aller faire dans cette galère? » Nuits blanches, mais peur bleue que mon contenu ne soit pas pertinent et fasse patate. Or les choses se sont très bien passées, pour dire le moins. Cela me rassure, mais la folle du logis, par définition, n’est pas raisonnable.
Je connais quand même un peu le public européen, pour m’être adressé à lui dans divers contextes, notamment à l’ATA justement, puis aux événements « On traduit à », et maintenant tous les mois dans le cadre de mes cours en ligne pour Magistrad. Je reconnais chez lui la même soif de perfectionner l’art de traduire et la même fascination pour notre travail, et au-delà de toutes mes incertitudes, je ne doute pas que nos rencontres seront de véritables célébrations de cette passion commune et des amitiés franco-québécoise et belgo-québécoise.
Sortir de sa zone de confort, pourquoi pas?
Ma valise est probablement trop volumineuse. Mes cours et conférences ne sont peut-être pas encore tout à fait adaptés. Je vais sans doute me perdre quelque part une fois ou deux sur mon itinéraire. Deux semaines avant mon départ, une tendinite m’est apparue comme par enchantement au pouce gauche, complétant à merveille l’épicondylite que je traîne depuis deux mois au bras droit. Simple coïncidence, bien sûr. Chose certaine, à 61 ans, je réapprends à sortir de ma zone de confort. Mais je mesure pleinement la chance que j’ai, après avoir pris ma retraite du cabinet Edgar à l’automne 2023 et cédé Magistrad à ma successeure Mélodie Benoit-Lamarre au printemps 2024, de pouvoir me permettre un voyage de trois semaines où je renouerai avec une France bien-aimée et une Belgique fraternelle. Merci à Caroline Tremblay, qui a pris l’initiative de cette aventure et qui m’a soulagé d’une bonne partie de ce stress nouveau en prenant en charge toute l’organisation logistique du voyage.
Quant à moi, je survivrai sûrement. On s’en reparle!
Traduction publicitaire : soyez la chèvre!
Dans une publicité de chaussures de randonnée, l’entreprise Columbia a traduit BE THE GOAT par SOYEZ LA CHÈVRE.
Je suis Pékin
Qu’est-ce que la translittération? C’est la façon d’écrire dans notre alphabet les mots qui viennent de langues qui en utilisent un autre. Ce n’est pas de la traduction.
Traduire autour du monde
Qui n’a pas rêvé de travailler à l’étranger ? Annik LaRoche Bradford, elle, a décidé de passer du rêve à la réalité. Grande voyageuse, la propriétaire d’Accent Communication est partie, en juin dernier, faire le « tour du monde » avec toute sa petite famille. Armée de son portable et de sa fidèle clientèle — qu’elle avait bien préparée…
-
François Lavallée est-il vraiment à la retraite?

Pour lancer sa nouvelle série de portraits de formateurs et formatrices, Magistrad s’est entretenu avec nul autre que son fondateur, François Lavallée, qui revient sur ses 40 ans de métier et nous parle de sa retraite… plutôt occupée!
François, tu as pris ta retraite il y a bientôt un an, et tu avais commencé ta carrière en 1984. Quel regard portes-tu sur ces 40 ans de métier?
C’est assez vertigineux. J’ai passé 40 ans à chercher la réponse à une seule question : comment se fait-il qu’il soit si difficile de rendre avec naturel en français un texte que je comprends parfaitement en anglais? C’est toute la question de l’idiomaticité, le mot-clé de toute mon action dans notre domaine. Sur mon chemin, j’ai traduit et révisé des millions de mots, écrit trois guides de traduction, fondé une école de traduction où j’ai donné des cours à des milliers de personnes de plusieurs pays, enseigné 15 ans à l’université… et je ne crois pas encore avoir ma réponse! (rires)
Tu as sûrement des pistes, quand même?
Oui, des pistes, j’en ai plein! Et j’ai plein de réponses pour un tas de questions bien précises sur la manière de traduire tel ou tel mot, sur l’utilité de tel ou tel procédé… Ça, pour ça, j’ai tout un coffre aux trésors! Mais ultimement, je me sens encore très démuni quand vient le temps de produire un texte à la hauteur de mes idéaux.
Tes idéaux sont peut-être trop élevés?
Pfff! Va dire à un artiste que son idée de la beauté est trop élevée, à un chercheur qu’il est trop ambitieux! On n’en a jamais fini, et c’est ce qui fait la beauté de notre métier! Si je n’avais pas été animé par cette recherche, j’aurais vite trouvé mon travail ennuyant. D’ailleurs, plein de gens me disent qu’ils ont retrouvé leur motivation après avoir suivi mes cours, pas nécessairement à cause des trucs concrets que j’enseigne (quoique j’ose croire que ça aide!), mais simplement en raison de l’approche de la traduction que je propose : à la fois un art, une technique et un mystère.
… un mystère que tu comptes encore résoudre?
Écoute… je crois que j’y touche presque, comme Adam touche presque le doigt de Dieu au plafond de la chapelle Sixtine… (rires) Sérieusement, avec la « technique de la feuille retournée », que j’expose dans ma formation Libérez le génie de la langue! (formation que je donnerai à Lyon en octobre et que je résumerai devant les étudiants de l’ESIT et au congrès de l’OTTIAQ en novembre), je sens que j’y suis presque.
Donc… ça y est???
Oui, peut-être, mais la réponse que j’ai trouvée m’emmène si loin que ça m’étourdit moi-même. Un peu comme quand Indiana Jones finit par trouver l’Arche d’alliance! Avec ma réponse, j’ai l’impression de changer de dimension. Car en fait, ce que j’ai toujours soupçonné, c’est que pour produire « une traduction qui ne sente pas la traduction », il ne faut pas dire exactement la même chose que le texte de départ. C’est troublant. Mais quand on l’assume, on découvre un tout nouveau monde. Je ne croyais pas si bien dire quand j’ai inventé le concept de « paradis du français » il y a maintenant près de vingt ans.
En même temps, cette réponse arrive peut-être à temps, au moment où la machine se mêle de traduire de manière de plus en plus impressionnante… mais inhumaine.
À t’entendre, on n’a pas vraiment l’impression que tu es à la retraite…
J’ai pris ma retraite de chez Edgar, qui était mon employeur à temps plein. J’ai aussi vendu Magistrad au printemps 2024, donc je suis beaucoup plus libre qu’avant. Mais c’est sûr qu’on ne se sépare pas de sa passion…
On pourrait donc dire que la retraite, c’est « un autre genre de paradis »?
Après un an, je ne peux pas dire que je me suis encore habitué à ce nouveau mode de vie. Dans ma carrière, on m’a souvent demandé où je trouvais le temps pour dormir… Je constate en effet que je menais beaucoup de choses de front, et ça me fait bizarre, quand je me lève le matin, de me dire que personne n’attend rien de moi aujourd’hui – sauf l’organisatrice de ma tournée européenne, qui n’arrête pas de me demander mille choses… (rires). Cette baisse de régime me fait réaliser à quel point j’étais effectivement occupé.
Syndrome du nid vide?
Je n’irais pas jusque-là. Je suis encore très actif, mais j’ai juste plus de temps pour faire mes choses et prendre le temps de vivre.
Comment as-tu vécu le transfert de Magistrad à Hermès?
C’est le plus bel aboutissement dont j’aurais pu rêver. Quand j’ai fondé Magistrad, en 2006, je voulais juste me donner un moyen de parler de traduction avec mes confrères et consœurs. J’étais loin d’imaginer que ça prendrait un tel essor, et encore plus loin de croire que quelqu’un pourrait prendre la relève aussi efficacement que Mélodie [Benoit-Lamarre], c’est-à-dire en respectant à 100 % l’esprit de Magistrad, mais en l’amenant plus loin.
Parlant d’aller plus loin, Mélodie a rapidement eu des projets pour toi, non?
Oui! Mélodie et son acolyte Caroline [Tremblay] – qui, en passant, sont deux de mes anciennes étudiantes de l’Université Laval avec qui j’avais toujours gardé contact – me font le cadeau de me concocter une tournée européenne en octobre-novembre. J’étais déjà allé donner des formations en Europe, mais jamais dans le cadre d’une tournée organisée par Magistrad. C’est justement le genre de choses que je ne pouvais pas faire avant… parce que j’avais quand même un emploi à temps plein chez Edgar!
Tu nous promets de nous parler de ton expérience?
Si tu insistes… J’ai l’intention d’être très actif sur le blogue de Magistrad, et sur les réseaux sociaux. On va d’ailleurs profiter de l’occasion pour lancer notre compte Instagram. Tout un programme!
Donc, Magistrad demeure au cœur de ta retraite?
Oui, mais pas seulement. J’ai aussi commencé la réalisation d’un vieux rêve : la rédaction d’un livre sur la langue française, mais pour le grand public.
Tu peux nous en dire plus?
Toute ma vie, j’ai écrit des livres et des articles sur la langue pour les traducteurs. Mais la langue, ça intéresse tout le monde. Tout le monde a une opinion sur le français, les anglicismes, la norme, l’orthographe, etc. J’avais envie de donner mon point de vue en tant qu’amoureux de la langue, à la fois pour faire connaître les enjeux de la traduction au grand public, et aussi pour transmettre ma passion. Mon titre provisoire : Ma langue française, tout simplement. Ce sera beaucoup sur le mode du témoignage subjectif.
Et on pourra lire ça quand?
La rédaction avance bien, mais c’est long. D’autant plus que je suis… à la retraite! (rires) Sérieusement, je me donne comme objectif de garder une certaine discipline sans trop me stresser avec une échéance. Pour l’instant, j’ai 90 000 mots d’écrits, et je n’en suis pas encore à la moitié… J’espère néanmoins terminer début 2025.
On a bien hâte de te lire, en tous cas. Merci mille fois pour ta grande générosité, François, et au plaisir de te suivre dans tous tes projets!
Pour ne rien manquer de la tournée européenne et des autres projets de François Lavallée, abonnez-vous à l’infolettre de Magistrad et suivez-nous sur nos réseaux sociaux!
-
Les Français font-ils plus d’anglicismes que les Québécois?

Dès qu’il est question de comparer la langue québécoise à la langue parlée par nos cousins français, les Québécois sont prompts à monter sur leurs grands chevaux pour dénoncer l’épouvantable propension qu’on a en France à utiliser des mots anglais. Toujours les mêmes exemples reviennent : shopping, bowling…
Il est vrai que Macron, avec sa start-up nation, son team building et ses bottom-up process, ne fait rien pour aider la cause. Mais la question demeure : les Français font-ils plus d’anglicismes que les Québécois, ou plus exactement, les commettent-ils dans les mêmes contextes et pour les mêmes raisons? Serait-il possible, par exemple, qu’il y ait une différence selon qu’on parle de la langue du marketing et des affaires ou plutôt de la langue de tous les jours?
Et surtout, se pourrait-il que l’on remarque davantage les anglicismes de nos cousins parce que ce ne sont pas les mêmes que les nôtres, alors que notre langue à nous en est truffée sans que nous ne nous en apercevions?
Allons-y voir à l’écran
La youtubeuse bien connue Solange, québécoise d’origine et française d’adoption, en avait assez de ces accusations, et elle a trouvé un moyen original de faire une petite étude sur la question : elle a regardé le film québécois Starbuck puis son adaptation française Fonzy (donc deux films comparables puisqu’ils racontent la même histoire), pour compter les mots anglais employés dans l’un et dans l’autre.
Résultat : vingt-quatre dans le film québécois contre… un seul dans le film français.
Dans les commentaires sous la vidéo de Solange, une Québécoise tient à faire une mise au point : « […] nous savons tous que le language [sic] “québécois” dans les films est extrêmement exagéré surtout dans un film du style de Starbuck. » Voire!
Un autre petit coup, juste pour être sûr?
J’ai donc eu l’idée de faire la même chose avec l’émission Un souper presque parfait, qui existe aussi en France sous le titre Un dîner presque parfait. La formule des deux émissions est la même, à ceci près que la québécoise dure 22 minutes et la française une heure. J’ai donc écouté deux épisodes québécois (de deux semaines différentes, pour varier les locuteurs) et les 44 premières minutes d’un épisode français, en comptant à mon tour les vocables de la langue de Shakespeare (ou de Richler, c’est selon).
Et là, ce n’est pas un script de film, c’est du vrai parler par du vrai monde (qui, accessoirement, mange du vrai manger).
Le résultat? 36 mots anglais du côté québécois, contre 14 du côté français. Moins spectaculaire que les chiffres de Solange, mais tout de même suffisant pour éclairer la discussion. Surtout que du côté français, j’ai ratissé large, en comptant show, cocktail, bling-bling, cool, « je suis fan de mayonnaise », too much, flop et french cancan, autant de mots qui auraient pu en fait être prononcés des deux côtés de l’Atlantique. Si on les exclut, on tombe à 6 (voir tableau ci-dessous).
Si je fais le même exercice de « neutralisation » du côté québécois, je peux éliminer googler et look, et même, disons, snow (au sens de snowboard), yes! et shortcake (les Français n’en mangent pas, mais on peut supposer qu’ils appelleraient aussi ça un shortcake s’ils en mangeaient), et on arriverait à un résultat final de 31 contre 6. Sinon, du côté québécois, ça part dans tous les sens, depuis le six-pack (abdomen musclé) jusqu’au show stopper et au vin cheap, en passant par « il a manqué sa shot », « c’est fair », « on se met en chest », « dix minutes, c’est très short », « ça va devenir un gros mess », « le dessert était fluffy » ou même « j’ai fail[ed] ». Beaucoup d’exclamations aussi, comme all right!, yes!, oh my God! ou that’s it!, ce qui est intéressant car cela montre l’imprégnation de l’anglais dans la pensée spontanée : en France, les mots anglais sont indéniablement des emprunts à une langue étrangère. Ici, l’anglais, c’est un peu aussi « la langue de chez nous »!
J’ai moins porté attention aux anglicismes francisés, et en fait je n’en ai remarqué qu’un : « à date ».
Caractéristiques sociodémographiques
Notons que, du côté québécois, il y avait dans la première émission la chanteuse d’opéra Nathalie Choquette, dont il est sans doute prudent de dire que sa langue est plus policée que celle de la moyenne des Québécois, et Benoît Gagnon, animateur télé de profession, qui surveillait manifestement son langage aussi; dans la seconde (qui se passait à Longueuil), il y avait un Français et une Russe d’origine, deux personnes dont le vocabulaire n’était pas non plus typique du Québécois moyen. Sauf erreur de ma part, aucune de ces quatre personnes n’a utilisé de mot anglais, ce qui a certainement amélioré la moyenne de l’équipe…
Du côté français, les cinq participants étaient de la région de Grenoble et ne présentaient en apparence aucune caractéristique sociodémographique pertinente pour notre propos.
J’ai aussi inclus dans mon décompte, évidemment, les commentaires des deux animateurs respectifs.
Voici un petit tableau des mots anglais relevés :
Émissions québécoises Émission française Catégorie 1
Mots utilisés des deux côtés de l’Atlantique– j’vas le googler
– le look de mon assiette
– un shortcake
– je fais du snow l’hiver
– yesss!– un cocktail
– le show
– une soirée french cancan
– c’est cool
– je suis fan de mayonnaise
– un petit flop
– c’est too muchCatégorie 2
Mots anglais relativement intégrés au lexique québécois mais non français– je trippe au boutte
– une fille de party
– c’est tough à mesurer
– le chou de Bruxelles est tough
– quelqu’un qui met le fun dans’ place
– du vin cheap
– le chum à ma sœur
– du make-up permanentCatégorie 3
Mots dont l’origine anglaise est ressentie comme telle même au Québec– ça c’est la partie fucking longue
– ça va devenir un gros mess
– le dessert était fluffy
– le dessert était un show stopper
– on rajoute du salt and pepper
– on se met en chest
– il montre son six-pack
– on est entre boys
– on ajoute le cheese
– elle est touch, elle touch beaucoup
– le temps était short, dix minutes c’était short1
– il a manqué sa shot
– j’ai fail[ed]
– c’était son call
– l’entrée était très basic
– c’est fairCatégorie 4
Exclamations spontanées– all right!
– oh my God!
– cheers!
– that’s it!Catégorie 5
Mots utilisés en France mais pas au Québec– customisation
– smartphone
– ce serait top
– un gros challenge
– je les ai bluffés
– je crains un clashSoyons clair : malgré ces statistiques, je n’avais pas l’impression, même du côté québécois, d’entendre des incultes qui ne connaissaient pas leur langue, ni une langue française en perdition. Trente et un, cela représente une fraction infinitésimale du nombre de mots qui sont prononcés en quarante-quatre minutes. Je ne suis donc pas en train de déchirer ma chemise pour dénoncer à quel point « les Québécois parlent mal ». Je cherche seulement à remettre en perspective les perceptions sur l’emploi généralisé de mots anglais de chaque côté de l’Atlantique.
Cela dit, il me semble évident que si on faisait la même étude du côté de la publicité, de l’affichage et de certaines revues, les Français gagneraient haut la main (témoins les photos ci-dessous, tirées de la revue française Vital Food). Cela montre que l’anglais, en France, est une question d’image et de façade, tandis qu’au Québec, c’est une question d’imprégnation culturelle.


1 Une source généralement bien informée m’indique que short gagnerait du terrain chez les jeunes générations en France.
-
« La langue évolue, mais le discours sur la langue aussi. »

Nous reproduisons ici à titre documentaire le discours prononcé par François Lavallée lors de sa réception comme membre d'honneur de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) le 5 novembre 2020.
Monsieur le Président,
Madame la Directrice générale,
Mesdames et Messieurs les invités d’honneur,
Chers collègues et amis,Je fais partie de la toute dernière génération de traducteurs ayant connu le crayon au plomb et la gomme à effacer comme outils de travail. Près de 40 ans plus tard, je suis invité à réfléchir avec des collègues à l’incidence de la traduction automatique, et même neuronale, sur notre profession. Entre temps, j’ai vu de vieux collègues, dans les années 1980, espérer de tout cœur pouvoir prendre leur retraite avant qu’on leur impose le traitement de texte.
Souvenirs et premières armes
Je garde de ces années archaïques un souvenir émouvant. Je ne résiste pas à la tentation, du fond de mon sous-sol de confinement en cette année 2020, d’arracher de ma bibliothèque quelques objets qui faisaient notre quotidien à l’époque, à savoir des dictionnaires sur papier. Vous avez ici le Webster’s pas en ligne, avec lequel j’ai fait mes premières armes dans l’approfondissement de la langue de Shakespeare comme futur traducteur, ou encore le fameux Ginguay, que reconnaîtront tous ceux de ma génération, premier grand dictionnaire d’informatique datant de l’époque où l’on apprenait des mots bien mystérieux comme logiciel et mémoire vive. Pour être franc, même si j’apprécie l’avènement d’Internet, grâce à quoi il ne m’est plus nécessaire de m’absenter deux heures pour trouver un article de loi à la bibliothèque, j’ai tout de même la nostalgie de l’époque où traduire, c’était passer la journée entouré de livres ouverts.
Je me vois encore aborder ma toute première traduction pour mon premier cours de version à l’Université Laval, en septembre 1982. C’était un article du Globe and Mail, photocopié, comme il était d’usage à l’époque. Si je me souviens de ce moment, c’est à cause de l’excitation que j’éprouvais alors et qui ne s’est jamais éteinte par la suite : j’allais m’attaquer à un texte, pour mettre en français ce qui existait en anglais. Déjà, j’étais fasciné par le mystère de la traduction : comment se fait-il qu’il soit si difficile de prendre un texte qui est clair et net dans une langue étrangère pour exprimer les mêmes idées de façon tout aussi claire et nette dans ma propre langue?
Les voies qui mènent à notre profession sont multiples. Très souvent, c’est l’appel de l’exotisme qui pousse les gens vers cette activité. Pour ma part, je me suis certes intéressé aux langues étrangères très tôt dans ma vie, mais le moteur premier de mon attrait pour la traduction, ce fut ma passion pour la langue tout court. Les mots, les lettres même, m’ont toujours fasciné. Je me revois à l’âge de quatre ou cinq ans, harcelant ma mère pour qu’elle m’apprenne à lire alors que celle-ci préférait que j’attende d’entrer à l’école. Mon acharnement a eu raison de ses préventions. Dès ce moment, je me suis mis à lire tout ce qui bougeait. Après les romans jeunesse, j’ai découvert Balzac à 14 ans, Molière l’année suivante. Pour l’écriture, même précocité : en première année du primaire, lorsque l’institutrice nous a demandé ce que nous voulions faire dans la vie, au milieu des petits garçons qui voulaient tous être pompiers et joueurs de hockey, j’ai laissé tomber un mot que la plupart n’avaient encore jamais entendu : écrivain.
La passion de la langue, donc, d’abord et avant tout, et en l’occurrence, de la langue française. Adolescent, j’ai appris des mots, je me suis frotté à la versification, j’ai exploré l’étymologie, j’ai dévoré des livres sur le style, je me suis extasié devant l’évolution de la langue depuis Michel de Montaigne jusqu’à Michel Tremblay, et aussi devant les disparités entre ma première langue maternelle, le québécois, et celle qui me venait d’outre-mer. J’ai ici une pensée particulière pour la revue hebdomadaire Pif Gadget, qui a tant fait pour élargir mon vocabulaire, donc mon esprit et ma capacité de penser le monde, mais il faudrait aussi citer Tintin et tant d’autres.
C’est ainsi qu’indéfectiblement, de Lucky Luke au Misanthrope, je me suis attaché à découvrir cette langue qui réunit tant d’univers depuis plus de cinq siècles, tout en me l’appropriant en tant que Québécois entré dans le monde intellectuel durant le dernier quart du XXe siècle.
Évolution du discours sur la langue
La langue évolue, mais le discours sur la langue aussi. Et ce n’est pas sans une certaine tristesse que j’ai vu survenir, au fil de ma carrière, un certain discours réducteur sur la langue. Un discours qui veut faire de la langue non pas un outil de dépassement, mais un plus bas dénominateur commun. Les origines de ce discours sont faciles à cerner, au moins sur deux plans. Sur le plan psychologique, il trouve ses racines dans l’humiliation que trop d’enfants ont connue dans l’apprentissage et la pratique du français. Ces enfants, devenus grands, lancent leur cri du cœur à toute la communauté : « Plus jamais! »
Sur le plan socio-historique, notre civilisation marche depuis longtemps vers la désélitisation, si vous me permettez ce néologisme. Vous me direz peut-être qu’il serait plus simple de parler de « démocratisation », mais ce terme est piégé, car il peut être interprété dans deux sens inverses. Dans le domaine de la langue, la démocratisation pourrait consister à alphabétiser toute la population, pour que la maîtrise de l’écrit ne soit pas l’apanage d’une élite qui en abuse. C’est le grand idéal hugolien du dix-neuvième siècle, qui a débouché sur l’instruction obligatoire, règle acquise depuis longtemps dans les pays occidentaux. Mais la notion de démocratisation peut aussi signifier qu’au lieu d’élever tout le monde pour donner à tous un accès au meilleur, il s’agisse de rabaisser les sommets pour mettre ceux-ci à la portée d’une population qu’on juge incapable d’apprendre. C’est ainsi qu’au lieu d’investir dans l’alphabétisation de ceux qui savent moins, par exemple, on investit énormément d’argent, de temps et d’énergie pour inciter ceux qui savent plus à sabrer leur lexique et à réduire la longueur de leurs phrases selon une règle mathématique. C’est ainsi que, pour la première fois depuis les grands idéaux démocratiques qui remontent aux Lumières, la société renonce à progresser pour plutôt se donner comme horizon la régression et le rabougrissement. Au lieu de tirer l’ensemble vers le haut, on coupe les têtes qui dépassent.
Je sais que mes propos peuvent sembler insensibles, voire déconnectés d’une réalité, pour les tenants de cette approche. Mais la perspective que je valorise ne repose ni sur l’insensibilité, ni sur la déconnexion, et encore moins sur l’élitisme; c’est au contraire une vision élargie du problème. Et d’ailleurs, ce n’est certainement pas elle, ma vision, qui est la plus méprisante pour le grand nombre. Tout le monde, moi le premier, reconnaît que tout citoyen doit comprendre les communications que lui adresse l’administration, par exemple. Et il était légitime qu’on sensibilise les spécialistes engoncés dans leur jargon et les rédacteurs maladroits de l’État à la nécessité de clarifier leurs propos. Mais l’enfer étant pavé de bonnes intentions, on en arrive, en poussant le curseur trop loin, à mutiler délibérément la langue de tous pour remédier au problème d’une minorité, peut-être parce que, collectivement, nous trouvons que c’est plus simple de procéder ainsi que de se demander pourquoi le tiers de la population est analphabète fonctionnelle dans une société où l’instruction est gratuite et obligatoire.
Le discours sur la langue évolue aussi sur la question de l’orthographe et de la grammaire. Là où, pendant des générations, il était naturel de considérer que l’apprentissage de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe étaient des leviers privilégiés pour apprendre à penser, à raisonner, à analyser et à synthétiser, on en vient de plus en plus à considérer ces dimensions de la langue comme de simples trouble-fêtes entravant la liberté, l’individualité et la spontanéité. Le fait est que la langue, malgré tout l’édifice de ses règles érigé au fil des générations, n’a jamais été une entrave à la spontanéité, pas plus que l’harmonie en musique ou les mathématiques en architecture. De tous temps, dans tous les secteurs, des locuteurs – à l’écrit ou à l’oral – ont fait évoluer la langue, se la sont appropriée, se sont permis des écarts et des libertés, que ce soit pour nommer des réalités nouvelles, pour changer notre regard sur la réalité, ou simplement pour s’amuser avec la langue, en tester les contours, voire carrément jouer les iconoclastes. Que la langue évolue, c’est une évidence, et même une nécessité. Que chacun ait son idiolecte, avec ses qualités et ses aspérités, c’est aussi naturel, et c’est cette diversité qui en fait une richesse collective. Mais ce qu’il y a de beau dans la langue, c’est justement qu’elle n’est pas individuelle. La langue est un héritage collectif. Personne n’a inventé la langue qu’il parle. Nous l’avons tous apprise de nos parents, qui, eux, en avaient aussi hérité des générations précédentes, avec d’inéluctables transformations. Et le français a cette particularité d’avoir été aimé, porté aux nues, travaillé, étudié, décortiqué, perfectionné, ciselé, développé par des esprits qui nous dépassent et qui nous l’ont ensuite transmise. Rabelais, Racine, Voltaire, Hugo, Saint-Exupéry, pour n’en nommer qu’un par siècle, nous ont appris à penser, à s’émouvoir, à rire en développant la langue. Prétendre aujourd’hui que cette langue perfectionnée n’est qu’un instrument de domination, c’est porter un jugement qui passe à côté des motivations profondes de ceux qui l’ont façonnée dans le but de nous léguer un instrument de plaisir esthétique et de croissance, c’est-à-dire un instrument d’humanité au sens le plus riche et le plus noble du terme.
Peut-être qu’il vous paraît incongru que j’évoque Racine et Voltaire en m’adressant à un public qui traduit au quotidien des bulletins internes, des communiqués et des instructions de connexion à une plate-forme infonuagique. Certes, on n’écrit pas une page Web sur les conditions d’admissibilité à une subvention avec les mots de Montesquieu ou de Camus, mais la philosophie qui nous incitera à choisir le mot juste et la juste formulation, c’est eux qui l’ont développée avant nous, et c’est sur ces précédents et ces outils que nous pouvons nous appuyer pour rendre clairement le message que nous avons pour mission de faire passer.
Je le répète : il ne s’agit pas de figer la langue dans un immobilisme mortifère. Il ne s’agit pas non plus de renoncer à l’idéal de clarté qui sous-tend tout le mouvement du plain language. En fait, je le dis régulièrement dans mes formations : tout en mettant en garde mes confrères et consœurs contre l’appauvrissement de la langue dont nous ne devons pas nous faire complices, je dois ajouter que lorsque je révise des traductions, au quotidien, les trois quarts de mes interventions consistent à simplifier et à clarifier le texte. Cela est loin d’être en contradiction avec la riche tradition que je viens d’évoquer. Déjà en 1784, Antoine de Rivarol déclarait : « Ce qui n’est pas clair n’est pas français. » On peut sourire, voire être choqué, aujourd’hui, devant les sous-entendus de cette phrase, et loin de moi l’idée qu’il soit impossible d’être clair en anglais, en latin ou en finnois, mais enfin, on voit bien ici que la clarté a toujours été un des grands idéaux des géants qui ont façonné notre langue. C’est de la maîtrise de la syntaxe et de la richesse du vocabulaire que naît la clarté, pas du mépris de l’un et de l’appauvrissement de l’autre.
Importance de préserver tous les ressorts de la langue française
Dans un monde, celui du Canada, où une proportion immense des écrits circulant en français sont passés par le filtre de la traduction, les traducteurs, avec ou sans la machine qui vient les épauler, jouent un rôle primordial, je ne dirais pas pour préserver la « pureté » de la langue – notion qu’on a évacuée depuis longtemps –, mais pour en préserver tous les ressorts, sans en faire passer aucun à la trappe du nouveau purisme, afin qu’elle exprime clairement les idées de tous ceux et toutes celles qui ont quelque chose à dire.
C’est notamment à cet idéal que j’ai consacré mes trente-cinq années de carrière, et de l’honneur insigne qu’on me fait aujourd’hui, je déduis que cet idéal est partagé collectivement par ma profession. Nous pouvons donc envisager tous ensemble un avenir où toutes les langues, dans toutes leurs variations, sauront, en partie grâce à notre action consciente et professionnelle, évoluer en clarté, en nuances, en richesses et en beauté. Bonne suite de congrès à tous et à toutes!
-
Comment traduire « cancel culture »?

Ce qu’on appelle la cancel culture fait beaucoup jaser depuis quelques années. On peut la définir comme la volonté de bannir de l’espace public une personne ou un personnage historique que l’on juge immoral, généralement en raison d’une inconduite (sexuelle ou autre) ou d’un comportement jugé raciste, sexiste ou transphobe. Cette suppression de l’espace public consiste par exemple, dans le cas d’un sportif ou d’un artiste encore vivant, à annuler ses contrats en cours (Guillaume Lemay-Thivierge) ou encore à interdire la diffusion des œuvres qu’il a créées (Polanski) ou auxquelles il a participé (Depardieu); dans le cas d’un auteur ou d’un intellectuel, à censurer ses ouvrages, à l’empêcher de tenir des conférences ou à le bannir de manifestations publiques ou sociales (J. K. Rowling); dans le cas d’un personnage historique, à réviser le portrait qu’on en fait, voire éventuellement à y rayer son nom, à démanteler les statues et monuments qui le représentent et à débaptiser les immeubles, voies publiques, etc., qui rappellent sa mémoire (Christophe Colomb).
L’expression cancel culture est généralement utilisée avec une connotation péjorative. Nous ne nous prononcerons pas sur le fond ici. Nous chercherons seulement quelle est la meilleure façon de traduire ce terme de façon idiomatique.
En anglais, to cancel, ce n’est pas tout à fait « annuler »
On voit souvent cancel culture traduit par « culture d’annulation » parce qu’« annulation » est le premier mot qui vient à l’esprit quand on voit le mot anglais cancel. En même temps, la plupart des gens sentent bien que cette expression « ne colle pas ». Et pour cause. Que peut bien signifier « annuler une personne » en français? Et on se dit que, décidément, les anglophones ont une façon bien bizarre de dire les choses.
Mais le problème n’est pas chez les anglophones : il est dans cette traduction trop rapide. Car le mot anglais cancel a un sens global beaucoup plus large que simplement « annuler ». Par exemple, to cancel a stamp, c’est l’oblitérer, c’est-à-dire lui apposer un cachet qui le marque, voire le masque, afin d’empêcher sa réutilisation. Le Robert & Collins traduit to cancel an application par retirer une demande et non pas juste l’« annuler ». Ce même ouvrage (que l’on ne consulte pas assez souvent, soit dit en passant) précise par ailleurs que si on parle d’un vol d’avion ou d’une ligne ferroviaire, il y a deux traductions possibles : annuler d’abord, mais aussi supprimer, dans le sens de withdraw permanently (donc supprimer définitivement une liaison). On voit bien ici que le champ sémantique de cancel est plus large que celui d’« annuler ». Un peu plus loin dans le même article, on signale que to cancel peut aussi signifier barrer ou rayer.
« Oblitérer », un mot trop… oublié
Ancien philatéliste averti, j’ai toujours en tête le mot oblitérer quand je vois le mot cancel. En effet, je me souviens du choc que j’ai éprouvé, vers l’âge de 11 ans, quand j’ai constaté que ce mot français si spécifique correspondait à un mot anglais si général.
D’où vient le mot oblitérer, et que signifie-t-il exactement? Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey nous apprend que ce vocable est attesté pour la première fois dans notre langue en 1512 avec le sens, de – tenez-vous bien – « effacer le souvenir de ». L’origine du préfixe ob- est assez… obscure, mais en gros, c’est l’idée de mettre un… objet devant un autre, ou par-dessus, pour le cacher. On peut penser à des mots comme obnubiler, obscène ou obsolète, qui évoquent tous l’idée de mettre à l’écart, de cacher ou de rendre caduc. La deuxième partie du mot oblitérer vient de la racine littera « lettre » ou « ligne d’écriture ». On se rapproche donc ici du sens de « barrer, rayer » attribué à to cancel dans le Robert & Collins. Le Dictionnaire historique de la langue française signale par ailleurs que le verbe oblitérer « a été rapproché de oblitus “oublié” ».
Il me semble donc que culture d’oblitération aurait toute la force nécessaire pour traduire cancel culture : ce qu’on veut faire dans ce genre d’entreprise, c’est oblitérer une personne, soit l’effacer ou la faire oublier. On retrouve dans ce mot l’expression d’une violence qui se trouve bel et bien dans cancel mais pas dans « annuler ».
Autres solutions
On a aussi vu comme propositions culture de l’effacement, qui me paraît tout à fait intéressant aussi, car il correspond bien au phénomène que l’on tente de décrire. C’est d’ailleurs un lieu commun que de faire un parallèle entre la cancel culture et les pratiques décrites dans le roman d’anticipation 1984, où les autorités publiques effacent littéralement certains noms des livres d’histoire, des anciens numéros de journaux, etc.
Cela dit, on peut aussi se demander si le mot même culture doit rester tel quel dans la traduction. Car s’agit-il d’une culture ou d’une pratique? Ou peut-être d’une mentalité? Ce sens de culture est probablement une influence anglo-saxonne, et bien qu’on puisse l’accepter parce qu’il est devenu courant (ne parle-t-on pas depuis récemment de la « culture de l’excuse »?), on peut quand même se demander s’il n’y aurait pas moyen de s’en passer.
De là, on tombe sur une autre proposition : le mot boycott, emprunté à l’anglais il y a une centaine d’années, et qui rend bien l’idée de cancel culture, du moins pour les personnes vivantes. Mais bon, s’interrogeront certains : à quoi bon se creuser les méninges pour trouver une traduction à un mot anglais… si c’est pour arriver à un emprunt de l’anglais? C’est vrai que la pirouette peut être comique, mais il reste que le problème de base, avec « culture de l’annulation », c’est que le mot « annulation » lui-même n’est pas assez fort pour traduire cancel dans ce contexte, et non pas seulement que ce serait un calque de l’anglais.
Il y aurait aussi ostracisme, mot bien implanté dans notre langue depuis la Renaissance cette fois, ainsi que la variante ostracisation. Ce mot désigne le fait d’exclure une personne à cause de son comportement. Son aïeul, ὀστρακισμός (« ostrakismos »), désigne un « vote par lequel certaines cités grecques bannissaient pour dix ans les citoyens qui avaient encouru la défaveur publique » (Wiktionnaire). On est vraiment très proche du concept contemporain, à ceci près que, dans notre monde à nous, la sanction est plutôt prononcée pour l’éternité.
Conclusion
Les mots boycott et ostracisation me semblent décrire parfaitement le cas des personnes vivantes dont on cherche, par exemple, à annuler les conférences ou les manifestations publiques. Ils me semblent toutefois insuffisants pour le cas des personnages historiques dont on veut honnir ou effacer ou la mémoire (Christophe Colomb, Claude Jutra) ou des artistes dont on veut faire disparaître les œuvres de la circulation (Polanski, Depardieu). Dans ces derniers cas, il me semble qu’il s’agit vraiment d’oblitérer ces personnes, c’est-à-dire les reléguer aux oubliettes, de les rayer du monde et de l’histoire. C’est pourquoi les termes culture d’oblitération, de suppression ou d’effacement me semblent particulièrement appropriés pour exprimer ce genre d’attitude et toute la force de cancel culture en anglais. Quant à l’opportunité de conserver ou non le mot culture, la question reste ouverte.
Mise à jour du 29 mars 2024 : Quelques autres solutions proposées par de fidèles abonnés au fil X de Magistrad :
- (phénomène d’)ostracisme systématique; appel à la censure; appel au boycott; culture de la censure (@PVirmouxJackson);
- damnatio memoriæ (@walttr);
- mise au ban, mettre au ban (@ProFRTrans; @PVirmouxJackson; @taquinvolubile).
-
Magistrad a désormais un formateur « émérite »! Mais ça veut dire quoi?

Les quelques personnes ayant communiqué avec François Lavallée dans le cadre de Magistrad ces derniers temps auront peut-être remarqué que le mot « président » a été remplacé par « formateur émérite » dans sa signature. Pourquoi?
C’est un clin d’œil à l’histoire étonnante de ce mot, que nous avons apprise quelques semaines avant la transaction.
Les origines du mot « émérite »
Dans Les secrets des mots, Jean Pruvost explique qu’on se méprend sur le sens premier du mot « émérite », à la faveur de sa ressemblance fortuite avec le mot « mérite ».
Emprunté au latin emeritus signifiant celui qui, ayant accompli son service militaire, jouissait des honneurs de son titre, l’adjectif émérite entrait dans la langue française au XIVe siècle pour désigner la personne ayant accompli pleinement sa carrière. Aussi est-ce encore aujourd’hui un titre précis : le professeur émérite de l’université reste celui qui, ayant pris sa retraite et satisfait à une appréciation valorisante de son travail par une commission constituée de ses pairs, peut en faire état et poursuivre des activités officielles d’enseignement et de recherche. Par définition, le magistrat et le professeur émérites bénéficient d’une longue pratique et attestent ainsi d’« une compétence et d’une habileté de haut niveau », selon la définition du Trésor de la langue française.
La proximité du mot mérite […] ne pouvait que contaminer au bon sens du terme le mot émérite, désignant le retraité de grand mérite. Remy de Gourmont, dans l’Esthétique de la langue française, traité publié en 1899, en fait le constat : « Quand le mot retraitéeut remplacé le mot émérite, celui-ci prit les significations de habile, expert et Balzac le vulgarisa. » On regrette qu’il ait même dévoyé le mot jusqu’à mettre en scène un voleur émérite dans Splendeurs et misères des courtisanes, en 1847. On préfère Georges Duhamel évoquant en 1906, dans sa Biographie de mes fantômes, « la consultation de Doleris, accoucheur émérite ». Quoi qu’il en soit, c’est un fait, la contamination linguistique n’est pas une maladie, juste un mécanisme naturel.
– Source : Jean Pruvost, Les secrets des mots, Guy Saint-Jean Éditeur, 2019, p. 192-193.Le Dictionnaire historique de la langue française nous permet de remonter plus loin : « Emeritus est le participe passé de emereri “achever le service militaire”, formé de ex- et mereri “gagner”. »
Le Petit Robert,pour sa part, met le doigt sur le sens intermédiaire ayant eu cours au XIXe siècle : « Qui a une longue pratique de la chose […]. ➙ chevronné, invétéré » Il y a donc ici le sens de l’expérience, sans encore le mérite ou la compétence.
Et François dans tout ça?
Notre ex-président François ayant passé la main pour la direction de Magistrad tout en maintenant ses activités de formateur, il nous semblait qu’il lui fallait un titre particulier. Puisqu’il a annoncé sa retraite en quittant le cabinet Edgar l’automne dernier et que la transmission de Magistrad constitue aussi un aboutissement, nous avons jugé que le sens premier de « émérite » lui allait comme un gant, pour ainsi dire (rappelons que de Gourmont indique explicitement que le sens premier était « retraité »). Le deuxième sens, celui de « chevronné, invétéré », nous semble justifié après plus de 40 ans consacrés à la langue et à la traduction.
Quant à la connotation moderne acquise « par contamination », nous ne saurions nous prononcer définitivement, mais elle est fort probablement… méritée.
-
En 2006, dans un obscur sous-sol de Duberger, naissait Magistrad…

Cette école a failli s’appeler « Traductart ». J’avais même fait un logo de mon cru. J’aimais l’effet miroir du TRA qui devenait ART à la fin, ce qui exprimait la vision qui allait être à l’honneur dans mes cours.

Mais je n’étais pas convaincu. Je n’aimais pas la prononciation ambiguë de la fin du mot (prononcer à la québécoise? à la française? entre les deux?). Et un court sondage maison m’a indiqué que cette dénomination ne soulevait pas l’enthousiasme.
Puis j’ai pensé à MAGISTRAD. Je ne sais pas comment ça m’est venu exactement. Mais la racine magis-, qui signifie « maître », me plaisait. Il s’agissait en effet de maîtriser cet art, et de l’enseigner.
Pour le logo, cette fois, j’ai pris la peine de faire appel à une graphiste. (Je n’ai pas fait comme ces clients qui essaient de traduire leur texte eux-mêmes parce qu’ils sont bilingues…) Après plusieurs va-et-vient, on a abouti au logo actuel, dont j’ai toujours été fier.

Quelques projets de logos de Magistrad à l’origine. Un site Web
Il me fallait aussi un site Web. Nous étions en 2006 : en matière d’Internet, ce n’était pas le même monde qu’aujourd’hui. Il n’y avait pas de sites du genre Wix ou GoDaddy à l’époque. Je connaissais un peu le html, mais de là à monter mon propre site Web…! Heureusement, je connaissais une fille de Saint-Eustache qui avait mis sur pied un site de critiques de livres. Je révisais lesdites critiques bénévolement depuis des années. C’est avec plaisir que Karine m’a donc offert de mettre sur pied mon premier site.

Bandeau d’en-tête du premier site se Magistrad Quand les gens s’inscrivaient à un cours, je recevais tout bêtement un courriel avec les informations de base. C’est avec beaucoup de dextérité que je m’étais concocté une super-macro-commande en Word pour transformer ces quelques lignes brutes en facture en quelques clics. Je retournais ensuite la facture en pdf par courriel.
J’étais déjà travailleur autonome depuis 1989, et j’avais donc un comptable. Celui-ci avait l’habitude de traiter une ou deux factures par semaine en moyenne. Tout d’un coup, je lui en envoyais des dizaines par mois! En effet, chaque inscription à un cours correspondait à une facture, évidemment. Celle de mon comptable a légèrement gonflé. C’était prévisible.
Il fallait aussi tout inventer côté logistique. Quels sont les lieux où l’on peut donner des cours? Comment organiser tout cela? J’avais déjà suivi des formations où les participants étaient laissés à eux-mêmes le midi, et je souhaitais éviter ces désagréments à nos « apprenants ».
J’ai fait le tour des salles à louer et des traiteurs, mais rapidement, j’ai constaté que la réservation d’une salle dans un hôtel doté d’un restaurant s’avérait la formule la plus pratique – d’autant plus que je tenais à « la formule Magistrad », selon laquelle le vin serait offert (à titre facultatif mais gracieux) aux participants. Les habitués se souviennent certainement de l’hôtel Lord Berri à Montréal et du Quality Inn de Gatineau où ont eu lieu les cours pendant de nombreuses années.
Un deuxième formateur
Au début, je n’avais pas pensé organiser des cours donnés par d’autres formateurs. Mais le hasard a fait que, au printemps 2006, quand j’étais sur le point de lancer le site Web, j’ai reçu un coup de téléphone de Christian Després qui me fait savoir au fil de la conversation qu’il aimerait bien donner son cours de traduction juridique à Québec et à Gatineau mais qu’il n’avait pas de cadre pour le faire. Une petite ampoule lumineuse est apparue au-dessus de ma tête : je m’étais doté d’une infrastructure, pourquoi ne pas en faire profiter d’autres formateurs?
Le cours de Christian a donc été annoncé aux côtés du mien dès l’ouverture. Car oui, il n’y avait à l’époque chez Magistrad que deux cours en tout et pour tout! Devant le succès de l’entreprise, je proposerai les volets II et III de La traduction administrative… idiomatique! en 2007 et 2008 respectivement, et je recruterai d’autres formateurs lentement mais sûrement.
Crise de croissance et constitution en société
En 2008, Magistrad comptait déjà plusieurs cours donnés par plusieurs formateurs. Les factures fabriquées semi-manuellement se multipliaient. Je m’occupais de tout : relations avec les formateurs, avec les hôtels, encaissement des paiements par carte de crédit (au téléphone), dépôt des chèques, gestion du site Web… Et n’oublions pas que, pendant ce temps, j’étais travailleur autonome avec encore toute ma clientèle antérieure à satisfaire, et que je donnais deux cours par année à l’Université Laval!
Je n’avais pas prévu cette dérive opérationnelle. J’ai tenté d’engager une adjointe à distance, mais c’était peu concluant. Ma semaine de travail gonflait à vue d’œil, j’étais aux abois.
C’est alors que Mathieu Foltz a croisé ma route. Il venait de fonder un cabinet de traduction, encore modeste et inconnu. Il souhaitait lui faire prendre son essor en embauchant un formateur qui serait apte à faire progresser ses jeunes talents. Il me proposait le poste. J’ai longtemps hésité à abandonner un statut de travailleur autonome auquel je tenais beaucoup, mais l’occasion était trop belle : Mathieu était un véritable entrepreneur et proposait de prendre en charge tous les aspects administratifs de Magistrad. J’ai accepté. Nous avons constitué l’entreprise en société, et Mathieu s’est chargé de faire moderniser mon site Web et de trouver une personne pour les tâches administratives. Je pouvais enfin respirer.
Croissance
Magistrad a ensuite pris son essor. J’étais agréablement surpris de constater à quel point nos cours étaient en demande. Nous donnions plusieurs dizaines de cours à plusieurs centaines de personnes chaque année. Nous organisions nous-mêmes des séances à Québec, Montréal et Gatineau (et, pendant quelques années, en Estrie et à Toronto). Mais nous étions aussi invités à répétition, soit par des employeurs, soit par des associations, à Halifax, Moncton, Fredericton, Toronto, Regina, Edmonton, Vancouver, Whitehorse, Yellowknife…
J’ai aussi été invité au siège de l’ONU à New York (pour animer des formations en traduction, pas pour représenter le Canada à l’Assemblée générale!), et j’ai aussi donné des formations à distance à l’équipe de Genève. Dernièrement, notre formateur Joachim Lépine a été invité à l’OTAN.
Recrutement
Je recrutais un ou deux nouveaux formateurs par année, généralement parce que je les connaissais personnellement et je savais qu’ils avaient beaucoup à apporter à la profession.
Je pense notamment ici à Serge Quérin, que j’avais vu en conférence et que j’ai harcelé pendant des années pour qu’il monte un cours de traduction médicale. Serge étant extrêmement occupé, il s’est fait tirer l’oreille mais a fini par accepter. Encore aujourd’hui, sa connaissance pointue du domaine et du vocabulaire médical s’avère inestimable pour notre profession grâce au cours qu’il donne dans le cadre de Magistrad.
Je me souviens que j’ai dû faire preuve du même acharnement avec Luc Labelle, auteur de l’impressionnant Les mots pour le traduire. Lorsque j’ai communiqué avec lui, il était en poste à l’étranger pour l’ONU. Je suis tout de même resté en contact et j’ai insisté pour qu’il se joigne à l’« écurie Magistrad » lorsque j’ai appris qu’il était rentré au Canada. Ce fut l’origine de ses fameux cours Les mots incontournables, qui remportèrent un immense succès.
Je pense aussi à Maurice Rouleau, avec qui j’ai pris contact après avoir lu un article de lui qui m’avait impressionné. Il fut un temps le formateur vedette de Magistrad.
Je ne peux non plus ne pas citer le cas très particulier de Marc Lambert. Marc était un simple participant parmi vingt autres dans un cours que je donnais à Montréal. Il avait assisté à mes trois cours, donnés trois jours d’affilée. J’avais été tellement impressionné par l’intelligence de ses commentaires que, dès mon retour à Québec, je lui ai écrit pour lui offrir d’être formateur pour Magistrad. Je ne savais rien d’autre de lui. Depuis, Marc a donné de nombreux cours fort appréciés à Magistrad, mais il a aussi participé à diverses éditions de « On traduit à » et a été un conférencier remarqué à l’OTTIAQ. Lui aussi apporte énormément à la profession.
Mes excuses à la trentaine d’autres formateurs que je n’aurai pas nommés ici : ceci n’est qu’un article de blogue qui s’avère déjà trop long. Je trouvais que ces quatre cas étaient dignes de mention pour exposer dans quel esprit j’ai bâti Magistrad. Mais bien que les conditions de recrutement n’aient pas toujours été aussi singulières, je suis fier et heureux de l’apport de chaque formateur et chaque formatrice de Magistrad, qui ont indéniablement contribué au succès de l’école.
L’Europe visite le Québec
Une des activités les plus réussies de Magistrad réside sans doute dans la session qui avait été mise sur pied à Québec et à Montréal spécialement pour un groupe d’une vingtaine d’Européens venus de France et de Grande-Bretagne pour l’occasion. C’était en 2018. Dix cours offerts par quatre formateurs en deux semaines! J’en ai profité pour organiser un 5 à 7 où j’ai livré un exposé sur le français québécois, et nous nous sommes en outre payé une soirée au Ciel!, le restaurant tournant au sommet du Concorde à Québec. Un événement mémorable! (Un merci tout particulier à Anne de Freyman, qui en a eu l’idée.)
Cours asynchrones et changement de plateforme
C’est en 2019 que nous avons lancé nos cours asynchrones, sur la plateforme Didacte, une entreprise de Québec. À partir de ce moment, nous avions donc deux plateformes : une pour les cours synchrones et une pour les cours asynchrones, ce qui n’était guère pratique. Nous avons donc fusionné le tout en passant à la plateforme uxpertise, une entreprise de Montréal, plateforme que nous avons baptisée epekhô en mémoire de Montaigne, en 2022.
La pandémie et les cours en ligne
Je me souviens que lorsque tout a fermé, en mars 2020, j’ai dit à Valérie, mon adjointe : « Annule tous les cours jusqu’à la fin avril. Ça ne durera sûrement pas plus longtemps que ça. » Évidemment, comme tout le monde, j’ai vite déchanté…
C’est alors que j’ai reçu un coup de fil salvateur de Joachim Lépine, alors tout nouveau formateur de Magistrad. Celui-ci me proposait de donner des cours en ligne.
Il faut savoir que, jusque-là, j’avais toujours résolument refusé de donner des cours à distance, même si les demandes se multipliaient de la part de participants potentiels qui se trouvaient en Europe, aux États-Unis ou hors des grands centres. Je l’avais fait une fois, pour un petit service de traduction, et j’avais trouvé l’expérience décevante. (Il faut dire que nous n’avions pas une installation optimale comme tout le monde apprendra à le faire ensuite avec la pandémie.) Mais surtout, je trouvais que cela dénaturait « l’expérience Magistrad ».
Ce n’était pas faux. Mais la pandémie ne me donnait pas le choix. Joachim avait déjà un peu d’expérience dans le domaine, et il me recommandait un consultant en la matière, soit Vincent Gagnon de Parlons données, qui s’est avéré encore jusqu’à aujourd’hui un partenaire solide.
Nous avons donc organisé nos premières séances par Zoom. Quelques formateurs ont préféré ne pas embarquer dans l’aventure à cause de la nature particulière de leurs cours, mais la plupart ont suivi le mouvement. Personnellement, j’ai fait un essai de bonne foi. Et finalement, je me suis rendu compte que c’était mieux que je ne l’aurais cru. Pour peu que les gens allument leur caméra, l’expérience s’avère même très agréable, et les interactions restent humaines et spontanées.
Les cours de Magistrad n’allaient donc pas ralentir à cause de la pandémie : au contraire, les inscriptions se sont multipliées, car on pouvait maintenant avoir des participants de partout au Canada et de l’Europe.
J’en ai profité pour faire nos premiers Facebook Live, grâce auxquels on peut maintenant assister à quelques extraits de cours sur la chaîne YouTube de Magistrad.
On traduit en ligne
J’ai participé aux séminaires « On traduit à » depuis leur institution, en 2009. Je n’avais jamais pris part à leur organisation, toutefois. Cette tradition est un peu particulière en ce qu’elle n’appartient à personne officiellement, et que les organisateurs changent souvent d’une édition à l’autre. L’instigation en revient à Chris Durban, mais Grant Hamilton en a aussi organisé plusieurs, et les éditions européennes ont été organisées par des associations.
En 2020, l’événement devait avoir lieu dans Charlevoix. Il a bien sûr été annulé, pour les raisons que l’on sait. Au début de 2021, on a conclu assez rapidement qu’il serait trop risqué de prévoir pour l’été suivant un événement « en personne » tout plein de microbes… J’ai donc décidé d’organiser, avec Magistrad, le premier « On traduit en ligne ».
Ce fut beaucoup plus compliqué que prévu, mais néanmoins un succès incontestable : alors que les événements sur place rassemblaient généralement une centaine de personnes (ce qui est déjà beaucoup!), On traduit en ligne a réuni plus de 250 personnes de partout sur la planète, du Liban à la Colombie et de l’Argentine à l’Australie, en passant par l’Afrique et, bien sûr, par les habitués d’Europe et d’Amérique du Nord.

Carte des participants à l’événement « On traduit en ligne » en 2021. Un blogue
C’est en 2022 que Caroline Tremblay m’est arrivée avec l’idée de créer un blogue. C’était une excellente idée, mais je n’avais pas le temps de m’en occuper. Elle a pris en charge ce projet avec Christine Fournier. Ce fut le blogue Pour ceux et celles qui aiment les langues, qui compte aujourd’hui une trentaine d’articles et a été visité plus de 11 000 fois en 2023 seulement.
La relève
J’ai fondé Magistrad il y a près de 18 ans. J’étais loin de penser à l’époque que l’entreprise aurait un tel rayonnement : tout cela m’a entraîné de Whitehorse à New York! Pourtant, pendant tout ce temps, j’avais un emploi à temps plein, et pas des moindres : vice-président à la formation et à la qualité dans un cabinet de traduction de Québec qui a lui aussi connu un essor phénoménal, passant d’une douzaine d’employés quand je suis arrivé en 2009 à une centaine quelques années plus tard. Et j’ai aussi été chargé de cours à l’Université Laval jusqu’en 2018.
Tout ça pour dire que, malgré les apparences, je n’ai pas pu consacrer à Magistrad autant de temps qu’aurait pu le faire un chef d’entreprise à temps plein. Je comptais le faire en prenant ma semi-retraite à l’âge de 60 ans (automne 2023), mais à l’approche de la date fatidique, et surtout après la pandémie, les difficultés impliquées par les changements de plateformes, le changement rapide du monde de la traduction et diverses autres embûches, une certaine fatigue s’est installée et il m’est apparu que le moment était venu de passer la main.
D’ailleurs, plusieurs acquéreurs potentiels commençaient à se manifester. C’était peut-être un signe. Mélodie Benoit-Lamarre en faisait partie. Je connais bien Mélodie depuis très longtemps. Pour tout dire, je l’ai eue comme étudiante (prometteuse, faut-il le dire?) à l’Université Laval au début des années 2000. Nous sommes toujours restés en contact. Je l’ai vue mettre sur pied le cabinet de traduction Hermès, à l’époque une coopérative. Nous avons fondé ensemble, avec Zoë Blowen-Ledoux et Caroline Tremblay, l’Association des travailleurs autonomes et micro-entreprises en services linguistiques (ATAMESL), projet que j’ai dû quitter rapidement en devenant salarié peu après. Mais nous avons toujours gardé le désir de « faire des choses » ensemble. Nous nous sommes affrontés dans quelques traduels (et un « traduo »!) à l’Université Laval. Bref, lorsqu’elle a appris que je songeais à passer la main, elle manifesté son intérêt. Je sais que Mélodie et Hermès ont des valeurs qui correspondent aux miennes et à celles de Magistrad, axées sur une passion réelle de la langue, sur l’humanité et sur l’intégrité.
Et voilà. À presque 18 ans, parvenue à l’âge adulte, Magistrad prend son essor et commence une nouvelle vie.
Un bilan
Est-il nécessaire de préciser que je suis fier de Magistrad? Au début, ce n’était pour moi qu’un véhicule pour m’adonner à la passion de la traduction et de l’enseignement. Au fil du temps, Magistrad est devenue une institution qui prône, à travers ses différents formateurs, une vision bien particulière de la traduction. Un idéal qui paraît peut-être illusoire à certains (et qui l’est à certains égards), mais qui fait du bien à tout le monde.
Car s’il y a une chose que j’ai constatée en lisant et en entendant les commentaires sur mes cours, dès les premières années, c’est que si les gens aiment les cours de Magistrad, ce n’est pas uniquement parce qu’ils y apprennent des choses sur la traduction. Ils y découvrent aussi une manière de voir la traduction. Pour certains, c’est une vision qui ne leur avait jamais traversé l’esprit. Pour d’autres, c’est une vision qu’ils avaient abandonnée au fil d’un parcours où d’autres façons d’aborder notre travail, moins motivantes, prennent le dessus. Pour d’autres encore, c’est une vision qu’ils entretenaient déjà et chérissent encore, et qu’ils sont ravis de voir mise en valeur dans des cours de formation permanente.
La traduction n’est pas qu’une technique. C’est aussi un art et un mystère. Magistrad a toujours été l’expression de cette façon d’aborder de notre activité.
Liste des formateurs ayant œuvré chez Magistrad depuis 2006 (par ordre chronologique)
- François Lavallée
- Christian Després
- Benoît Evans
- Didier Féminier
- François Gauthier
- Pierre St-Laurent
- Maurice Rouleau
- Jean-Paul Fontaine
- Robert Paquin
- Philippe Caignon
- Brian Mossop
- Nancy Kleins
- Louis Fortier
- Marc Lambert
- Luc Labelle
- Sylvie Lemieux
- Claude Bédard
- Marie-Christine Gingras
- Serge Quérin
- Christine Fournier
- Anouk Jaccarini
- Suzanne Deliscar
- Émilie Lévesque
- Jeff Staflund
- Laurence Jay-Rayon Ibrahim Aibo
- Maria Ortiz Takacs
- Joachim Lépine
- Jean-François Giguère
- Caroline Tremblay
- Mélodie Benoit-Lamarre
- Annie Bergeron
- Grant Hamilton
Quelques chiffres

Magistrad a désormais un formateur « émérite »! Mais ça veut dire quoi?
Les quelques personnes ayant communiqué avec François Lavallée dans le cadre de Magistrad ces derniers temps auront peut-être remarqué que le mot « président » a été remplacé par « formateur émérite » dans sa signature. Pourquoi? C’est un clin d’œil à l’histoire étonnante de ce mot, que nous avons apprise quelques semaines avant la transaction. Les origines du…
Les « traduels » de Magistrad sont-ils vraiment des formations?
Tout traducteur curieux et soucieux de perfectionnement trouvera dans les traduels une source d’inspiration inestimable.
Pour se faire comprendre : phrases courtes ou longues?
On peut démontrer avec moult exemples qu’une phrase complexe peut être limpide.
-
Magistrad passe le flambeau

Québec et Lévis, 11 mars 2024 – Le vendredi 1er mars 2024, Magistrad a changé de mains, ayant été vendue au cabinet Traductions Hermès, propriété de Mélodie Benoit-Lamarre et Pascal Danis.
L’école de perfectionnement Magistrad a été fondée en 2006 par François Lavallée, traducteur agréé et aujourd’hui membre d’honneur de l’OTTIAQ, dans le but de diffuser la passion de la langue et de la traduction au sein du milieu langagier. Elle a été constituée en société lorsque celui-ci s’est associé à Mathieu Foltz en 2009. Ses cours ont été donnés partout au Canada, de Halifax à Whitehorse, en passant par Montréal et Toronto, ainsi qu’à des groupes d’institutions internationales telles que l’ONU et l’OTAN. Depuis 2020, on constate avec plaisir la présence de plusieurs participants européens à la plupart de ses cours donnés en ligne.
« Magistrad a indéniablement un potentiel de développement encore inexploré, explique le fondateur François Lavallée. Je suis très heureux et très fier de passer le flambeau à Hermès. Mélodie et moi avons déjà plusieurs projets en tête », précise celui qui ne compte pas cesser ses activités de formateur.
Mélodie Benoit-Lamarre et François Lavallée sont des complices de longue date; ils ont notamment fondé ensemble, entre autres avec Caroline Tremblay et Zoë Blowen-Ledoux, l’Association des travailleurs autonomes et micro-entreprises en services linguistiques (ATAMESL) en 2007.
« C’est avec fébrilité et enthousiasme que nous prenons les rênes d’une entreprise pour laquelle nous avons toujours cultivé une franche admiration, confie Mélodie Benoit-Lamarre, copropriétaire de Traductions Hermès et nouvelle présidente de Magistrad. Depuis sa fondation, puis année après année, Magistrad a été pour nous et pour les membres de notre équipe un lieu incontournable d’apprentissage. Nous remercions François pour le travail accompli et pour l’honneur qu’il nous fait de nous faire confiance pour poursuivre son œuvre. »
Magistrad a compté au cours de son existence 32 formateurs de haut calibre, dont près d’une vingtaine sont encore actifs à des degrés divers. Son fondateur François Lavallée tient à les remercier d’avoir bâti avec lui cette institution qui, au-delà de l’enseignement en tant que tel, diffuse une vision bien particulière de la traduction, axée sur la passion du métier, l’idiomaticité et la richesse de la langue.
Les activités se poursuivront dans une continuité parfaite pendant la transition.
– 30 –
À propos de Magistrad
Magistrad est une école de perfectionnement en traduction fondée en 2006 par François Lavallée, traducteur agréé et aujourd’hui membre d’honneur de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ). Elle reçoit plus d’un millier d’inscriptions par année. Les cours de Magistrad, qui ne remplacent pas la formation de base, offrent l’occasion de perfectionner l’art de la traduction ou de se familiariser avec certains domaines de spécialité. Depuis le printemps 2020, Magistrad donne des cours en ligne qui lui permettent de rejoindre les traductrices et traducteurs de l’Europe et du monde entier. Des cours sont aussi régulièrement donnés à des groupes formés par des associations ou à des services de traduction sur invitation de l’employeur.
À propos de Traductions Hermès
Cabinet langagier fondé en 2008, Traductions Hermès est composé de traducteurs professionnels et passionnés qui cisèlent leurs textes avec l’amour des artisans, dans un travail collaboratif axé sur la complémentarité des forces de chacun. Privilégiant le contact humain, nous prenons plaisir à interagir directement avec nos clients, qui peuvent compter sur notre expertise diversifiée, notre contrôle rigoureux de la qualité, notre écoute attentive et notre célérité pour profiter d’une expérience sur mesure et clé en main.
Renseignements :
Mélodie Benoit-Lamarre
Copropriétaire de Traductions Hermès et présidente de Magistrad
info@traductionshermes.com
Tél. : 418-523-1943François Lavallée
Fondateur, ex-président et formateur émérite de Magistrad
francois.lavallee@magistrad.comLa traduction « idiomatique » : le Graal du traducteur
Si vous demandez à un traducteur de vous dire en quelques mots à quoi ressemble son idéal en traduction, ce qu’il est le plus difficile d’accomplir, il ne vous parlera pas de la difficulté de bien connaître une deuxième langue, ni de l’importance de bien rendre le sens du texte.
Au revoir Réal
Il publiait presque toujours une photo de la première neige…
Channeling Your Inner François
Transcript of the speech given by Manu Volaco at the Au-delà du traducteur averti book launch on October 19, 2023, in Montréal, and October 24, 2023, in Sherbrooke Good evening, bonsoir, In the spirit of my usual communication style with François, where we each speak the language we’re more comfortable in, I’ll be addressing you in English…
-
Les « traduels » de Magistrad sont-ils vraiment des formations?

On trouve dans l’offre de cours de Magistrad trois traduels :
- Un traduel entre François Lavallée et Marc Lambert portant sur un extrait d’entrevue avec Barack Obama.
- Un traduel entre Grant Hamilton et Chris Durban portant sur un programme d’insertion professionnelle des jeunes.
- Un traduel entre François Lavallée et Dominique Jonkers portant sur la notion danoise de « hygge ».
N.D.L.R. (octobre 2024) : Deux autres traduels se sont ajoutés depuis la parution de cet article :
- Réal Paquette vs Caroline Tremblay : An inclusive corporate Canada
- Traduel de la Saint-Jérôme 2024 (François Lavallée vs Marc Lambert : Slow Change Can Be Radical Change, début d’un article du New Yorker)
Un traduel a plus l’air d’un spectacle que d’une formation. Pourtant, si nous proposons ces trois traduels parmi nos cours, c’est parce que nous croyons à la valeur pédagogique bien réelle de cet exercice.
Qu’est-ce qu’un traduel?
Commençons par expliquer ce qu’est un traduel.
Un traduel est une épreuve par laquelle on demande à deux traducteurs de traduire le même texte chacun de son côté. Les deux traduellistes remettent leur traduction à une tierce personne qui s’occupe de créer un PowerPoint où les versions seront mises côte à côte. Puis, devant un public ébahi, on montre les deux traductions paragraphe par paragraphe et on constate à quel point deux personnes peuvent arriver à des solutions différentes pour un même point de départ.
À noter que l’exercice s’appelle translation slam en anglais, et que c’est votre humble serviteur qui a eu l’honneur de forger la traduction traduel à l’occasion de l’événement « On traduit à Québec » en 2013. En Europe, on parle souvent de joute.
Malgré ce que l’appellation laisse malicieusement entendre, il ne s’agit pas véritablement d’une compétition. (J’avais d’ailleurs hésité entre traduel et traduo comme traduction à l’origine. Cela dit, Mélodie Benoît-Lamarre et moi avons donné récemment un sens nouveau au terme traduo, exercice inédit que nous proposerons bientôt à la distinguée clientèle de Magistrad.) Un traduel se déroule toujours dans un esprit de camaraderie et de curiosité. Chaque traduelliste peut être fier de ses trouvailles, mais aussi se laisser éblouir par celles de l’autre.
Nul besoin de dire, par ailleurs, que l’exercice est particulièrement stressant pour les deux, car chacun travaille sans filet : logiquement, les textes ne sont pas révisés avant d’être exposés, et chaque traduelliste découvre la version de l’autre en même temps que l’auditoire.
Il n’y a pas vraiment de vainqueur dans un traduel : immanquablement, ce qu’on constate, c’est qu’un des deux traduelliste a trouvé une solution plus concise, efficace ou ingénieuse que l’autre pour la phrase a, mais que c’est l’autre qui a pris le dessus pour la phrase b. Sans compter les nombreux cas où les deux ont parfaitement relevé le défi, mais avec des solutions différentes.
Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble un traduel concrètement, on peut aller en voir deux extraits de vingt minutes sur la chaîne YouTube de Magistrad :
- Caroline Tremblay vs Réal Paquette : Aiming for the top: The push for an inclusive corporate Canada
- François Lavallée vs Dominique Jonkers : extrait de The Little Book of Hygge (extrait de la formation intégrale se trouvant sur la plate-forme de Magistrad)
Un traduel, est-ce vraiment une formation?
Dans un traduel, il n’y a pas de programme d’apprentissage particulier. En ce sens, on pourrait considérer qu’il ne s’agit pas d’une formation.
Mais nous considérons qu’en matière de traduction, l’apprentissage par l’exemple est une des meilleures méthodes qui soit. En effet, on peut vous égrener toutes sortes de principes et d’exemples hors contexte dans un cours, rien n’est plus inspirant que de voir le résultat du travail d’un traducteur chevronné qui a réussi à s’éloigner de l’anglais pour produire une traduction idiomatique.
Or un traduel montre non pas une, mais deux traductions (quasi) exemplaires. Qui plus est, dans un traduel, chaque traduelliste explique ses choix et commente les choix de l’autre. Et il y a aussi l’assistance, composée d’étudiants ou de traducteurs professionnels, qui proposeront encore d’autres solutions, ou alors confirmeront les bons coups ou remettront en question certains choix : n’y a-t-il pas un glissement de sens ici? une omission là? Il n’y a pas toujours de réponse définitive à ce genre de question. Mais ce qui est formateur, c’est de voir comment des traducteurs professionnels abordent ces questions, sur quoi ils se basent pour, par exemple, laisser tomber un élément d’information, étoffer, interpréter ou au contraire coller à l’anglais quitte à nuire un tant soit peu au style et à l’idiomaticité.
Pour cette raison, nous recommandons particulièrement les traduels aux jeunes traducteurs. Un jeune traducteur qui est exposé dès ses premières années à des traductions véritablement affranchies de l’anglais aura d’emblée une idée beaucoup plus concrète de ce qu’il doit viser comme traducteur que la simple contemplation des révisions apportées à ses textes ou l’apprentissage de diverses règles compartimentées de stylistique comparée.
Comment se servir d’un traduel de manière véritablement formatrice?
Les traduels de Magistrad comportent deux composantes :
- une vidéo d’environ deux heures,
- le texte à traduire, pour une durée de 90 à 120 minutes.
On peut évidemment se contenter de visionner la vidéo. Toutefois, nous recommandons vivement, pour décupler la valeur pédagogique de la formation, de commencer par traduire soi-même le texte. C’est pourquoi ces formations sont considérées comme des formations de 3,5 h ou 4 h même si la vidéo elle-même ne dure que deux heures environ.
En effet, pour saisir pleinement quelles étaient les difficultés d’un texte et bien apprécier la façon dont les traduellistes les ont résolues ou contournées, il faut s’y être confronté soi-même. Sinon, on voit directement la solution et elle nous paraît plutôt évidente. Mais c’est quand on peut comparer sa propre formulation maladroite (le cas échéant) à la solution des traduellistes qu’on peut mesurer et visualiser plus clairement le chemin à parcourir pour y arriver.
Les traduels, c’est pour tout le monde!
Nous avons dit plus haut que les traduels étaient particulièrement bénéfiques aux traducteurs débutants, et à ce titre, nous ne saurions trop recommander aux employeurs de les recommander à leurs recrues. Cela dit, le haut calibre des traduellistes s’affrontant dans le cadre de Magistrad fait que tout traducteur le moindrement curieux et soucieux de perfectionnement y trouvera une source d’inspiration inestimable.
Comme nous l’avons dit, la durée affichée pour chaque formation est de 3,5 à 4 h, mais en fait, la moitié de ce temps consiste à traduire soi-même le texte, et l’autre est constitué par une vidéo que l’on peut facilement interrompre après un segment de traduction quelconque, de telle sorte qu’il n’est nullement obligatoire d’avoir un bloc de quatre heures devant soi avant d’entamer ce genre de formation.
Les traduels de Magistrad, un beau cadeau à vous faire… ou à faire à vos employés!
Blogue sur la langue et la traduction, alimenté par les formateurs et formatrices de Magistrad